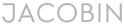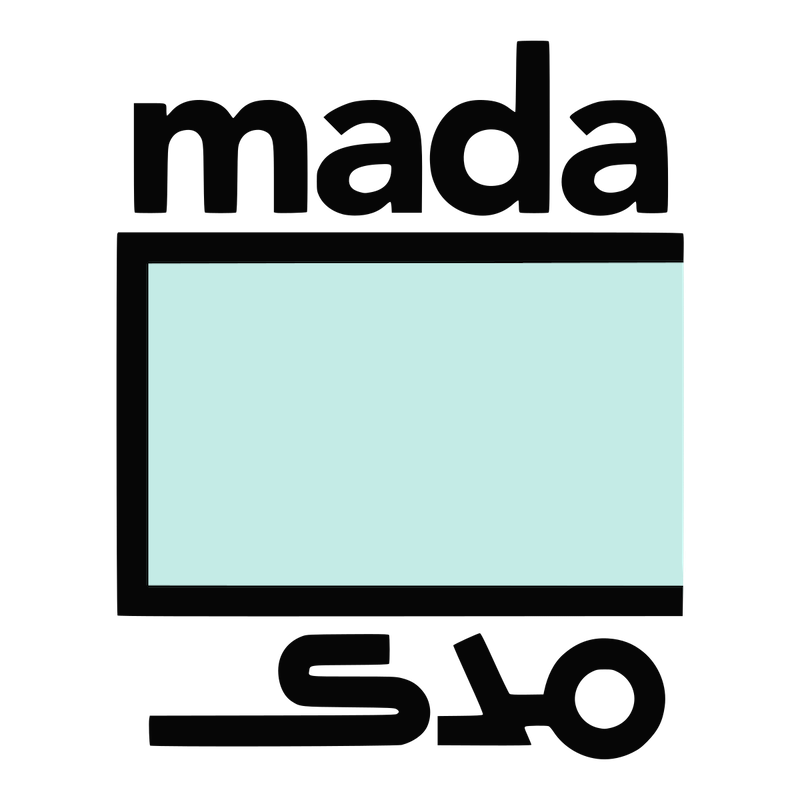Neuf mois après le coup d'État militaire qui a évincé le président de gauche Evo Morales, le gouvernement putschiste bolivien a suspendu les élections pour la troisième fois. En réaction à la décision de la présidente en exercice, Jeanine Áñez, de retarder le scrutin, la Centrale des travailleur·euse·s bolivien·ne·s (COB) a organisé des marches dans tout le pays, et un demi-million de personnes ont participé à la manifestation à El Alto. Dans son discours, le secrétaire général de la COB, Juan Carlos Huarachi, a menacé de déclencher une grève générale illimitée si les élections ne se déroulaient pas comme prévu.
La manifestation d'El Alto a été la plus importante depuis le lendemain du renversement de Morales en novembre, lorsque les autochtones qui protestaient contre le coup d'État ont été « abattu·e·s comme des animaux », tuant au moins trente-sept personnes. Pourtant, le président du tribunal électoral Salvador Romero, nommé par le régime putschiste, a ignoré les protestations, et le lundi 3 août, la grève générale illimitée a commencé sérieusement, avec des protestations, des marches et des barrages routiers qui se sont rapidement étendus à toute la Bolivie. En vingt-quatre heures, plus de soixante-quinze routes et autoroutes principales dans les provinces de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro et Potosí ont été complètement ou partiellement bloquées par les branches syndicales locales et les mouvements sociaux.
Les blocus appuyés par la COB ont été largement soutenus par les syndicats et les mouvements sociaux. Parmi les participant·e·s figuraient la Fédération syndicale des travailleurs des mines de Bolivie (FSTMB), les producteur·rice·s de coca (les six fédérations du Trópico de Cochabamba), la fédération des femmes Bartolina Sisa, la fédération des paysan·ne·s Tupac Katari et la Confédération syndicale des communautés interculturelles de Bolivie (CSCIB). Ces forces ont une histoire de mobilisations de masse contre les gouvernements néolibéraux, comme la guerre historique du gaz de 2003 et les guerres de l'eau de 2000 à Cochabamba.
Le 6 août, après les premiers jours de blocus, la Cour suprême électorale (TSE) a été contrainte d'ouvrir des discussions avec les mouvements sociaux concernant la date finale des élections.
Après une nuit de négociations tendues le 8 août, qui ont impliqué la COB, la TSE et les deux chambres de l'Assemblée législative plurinationale, aucun accord n'a été conclu. La Cour suprême continue de repousser toute tentative visant à rapprocher les élections de la date initiale du 6 septembre. Le lendemain, une tentative du régime Áñez de convoquer un dialogue politique national s'est soldée par un échec humiliant, car non seulement le Mouvement vers le socialisme (MAS) de Morales, mais pratiquement toutes les forces politiques ont boycotté la réunion, à l'exception de sa propre alliance « Ensemble » (Juntos) et de deux petits partis de droite.
Plus prometteur encore, il semble que sous la direction de Huarachi, la COB soit maintenant revenue à ses racines historiques de lutte pour la démocratie et contre la dictature militaire. En effet, si la COB s'oppose désormais fermement à la tentative du régime putschiste de retarder les élections, sa position était bien moins ferme il y a quelques mois encore. Alors que le régime putschiste cherche à éviter un test électoral, les développements à venir mettront à l'épreuve la puissance des mouvements sociaux boliviens et leur volonté de se tenir aux côtés de Morales et de ses allié·e·s.
Comment la COB et la FEJUVE ont échoué à défendre Evo
Cette relation ne peut être considérée comme acquise. Lorsque la Bolivie s'est dirigée vers des élections présidentielles en octobre 2019, l'alliance des travailleur·euse·s métis urbain·e·s et des mouvements sociaux autochtones rura·les·ux qui soutenaient depuis longtemps le gouvernement de Morales a commencé à s'affaiblir. Après quatorze ans de gouvernement, il ne restait pas grand-chose de l'esprit révolutionnaire qui avait conduit le parti MAS de Morales à la tête du pays. Et bien que Morales ait été crédité comme le premier président autochtone de Bolivie, cette distinction s'était usée avec le temps.
Lorsque les Bolivien·ne·s se sont rendu·e·s aux urnes le 20 octobre, pour décider s'il fallait lui accorder un nouveau mandat, il a recueilli 47 pour cent des suffrages. Cela peut sembler un score élevé dans une course à plusieurs candidat·e·s, mais en comparaison, en 2014, il avait remporté la victoire avec 61,36 pour cent de soutien. Le référendum constitutionnel de 2016, qui a permis à M. Morales et au vice-président Álvaro García Linera de se présenter pour un quatrième mandat historique, a vu le vote du MAS passer sous la barre des 50 pour cent pour la première fois depuis 2005, une perte importante qui a déclenché l'effet domino qui allait finalement aboutir au coup d'État de novembre 2019.
Si Morales a finalement obtenu le droit de se présenter à l'élection présidentielle de 2019, grâce à une décision de la Cour constitutionnelle plurinationale, l'opposition de droite a investi beaucoup de temps et d'énergie dans la construction d'un faux récit selon lequel la Bolivie était devenue un « narco-État » et une « dictature », étant donné le refus de Morales d'accepter les résultats du référendum. Ce récit a trouvé son expression dans l'extrême violence perpétrée pendant la campagne électorale d'octobre dernier par des groupes d'extrême droite comme le mouvement 21F, le groupe de résistance de la jeunesse de Cochala et l'Union de la jeunesse de Santa Cruz, suivie d'une mutinerie policière début novembre et du coup d'État militaire du 10 novembre.
Les fiefs autochtones du MAS ont subi le plus gros de la violence qui a entouré l'élection d'octobre. Les deux principaux massacres ont eu lieu à Sacaba, Cochabamba, contre les producteur·rice·s de coca loyalistes de Morales des six fédérations du Trópico, et à Senkata, contre les résident·e·s autochtonesaymarasauto-organisé·e·s d'El Alto (FEJUVE) [Federación de Juntas Vecinales de El Alto, « Fédération des conseils de voisinage d’El Alto »].
Face à une persécution aussi intense, ni la FEJUVE ni la COB n'ont défendu avec vigueur le gouvernement de Morales. Avec une énorme campagne médiatique de l'Organisation des États américains parlant de prétendues « fraudes électorales » et de manifestations de masse de la droite, et avec des militaires et des policier·ère·s exigeant la démission de Morales, le leader de la COB Huarachi s'est inscrit dans une démarche de « pacification ».
Comme de nombreu·ses·x dirigeant·e·s syndica·les·ux, il a reçu de graves menaces de mort ; et lorsque la police et l'armée ont forcé Morales à démissionner, Huarachi a déclaré qu'il devrait le faire si cela pouvait aider à « pacifier le pays ». De nombreu·ses·x partisan·e·s du MAS ont considéré cela comme une trahison et le président vénézuélien Nicolás Maduro a qualifié Huarachi de traître.
Pourtant, ces derniers mois, ces mouvements sociaux ont repris des forces et ont durci leur ligne. Cela est dû notamment à l'absence relative du régime Áñez pendant la crise du coronavirus, et à la demande de justice après une période de répression intense. Sous la direction de Basilio Villasante, la FEJUVE, qui fait partie du « Pacte d'unité » affilié au MAS, travaille avec les groupes de la COB avec lesquels le gouvernement Áñez a refusé toute négociation.
En annonçant la grève générale illimitée et les mobilisations de masse, la COB rétablit l'unité des paysan·ne·s, des mineur·e·s et des travailleur·euse·s urbain·e·s qui avait été perdue en novembre dernier. Au cours des dernières décennies, c'est précisément cette unité et cette mobilisation de masse permanente qui ont rendu possible la nationalisation des ressources naturelles et les quatorze années de gouvernement du MAS avec un développement économique réussi. Plusieurs semaines avant le début des marches, le leader des mineur·e·s Orlando Gutiérrez du FSTMB a déclaré : « Il ne s'agit plus d'un parti politique. Il s'agit de la dignité du peuple ».
La mémoire des luttes
Dans son discours à la manifestation d'El Alto, Huarachi a invoqué les luttes de l'histoire récente de la Bolivie, en notant comment il a lui-même marché pendant la guerre du gaz de 2003. « Comment pouvons-nous oublier ces luttes et ceux qui ont donné leur vie à ces luttes », a-t-il demandé, « Après de nombreuses années, le peuple est à nouveau uni et dit au gouvernement de respecter la date de l'élection du 6 septembre ».
Le lendemain de la marche, le régime putschiste a intenté un procès pénal contre lui et d'autres syndicalistes pour « promotion d'actes criminels et menace à la santé publique ».
Les mineur·e·s - représenté·e·s par le propre syndicat de Huarachi, la FSTMB - étaient le principal bastion de l'organisation des travailleur·euse·s bolivien·ne·s, à la tête de la révolution nationale des années 50, et de la résistance contre les dictatures militaires et les politiques néolibérales dictées par le FMI. Leur travail dans les mines, dans un pays fortement dépendant de l'exportation de minéraux, en a fait le secteur le plus fort - et le seul armé - des travailleur·euse·s organisé·e·s. La situation a changé avec la fermeture des mines d'État sous Víctor Paz Estenssoro en 1985, ce qui a sapé le syndicat.
Plus récemment, le gouvernement de Morales a empêché la fermeture des mines d'État et a accordé des subventions aux mines privées pour protéger les emplois relativement bien rémunérés. Cela a contribué à faire de la FSTMB (et de la COB) un allié proche dans le « processus de changement ». Mais même si la FSTMB a perdu une partie de son pouvoir, son héritage se poursuit dans des syndicats militants impliquant d'ancien·ne·s mineur·e·s, comme les Six Fédérations du Trópico, les producteur·rice·s de coca des Yungas, les associations syndicales d'El Alto et de nombreuses banlieues autochtones.
Ces organisations sont toujours sous l'influence idéologique de la culture autochtone pré-capitaliste, mais aussi des traditions syndicales. La COB a également une grande valeur symbolique étant donné son rôle historique dans la lutte pour la démocratie.
La COB doit donc représenter sa base traditionnelle parmi les travailleur·euse·s et, en même temps, parmi la classe moyenne autochtone qui a émergé sous la présidence de Morales, y compris un grand nombre d'étudiant·e·s universitaires. Sous le régime Áñez, une partie de cette nouvelle classe moyenne autochtone perd déjà les droits sociaux conquis au cours de la dernière décennie, avec des politiques néolibérales choquantes qui détruisent leur niveau de vie.
Ainsi, l'incapacité économique du gouvernement d'Áñez à faire face à la terrible situation économique et à la crise économique renforce les mouvements sociaux et la COB, tandis que le racisme du gouvernement ramène les autochtones de la classe moyenne dans le giron du MAS.
Les échos de 2003
Pour de nombreu·ses·x partisan·ne·s du MAS et des intellectuel·le·s de gauche comme Jorge Richter, il existe des parallèles évidents avec l'époque turbulente du néolibéralisme au début des années 2000, qui a préparé la montée initiale de Morales au pouvoir. Il existe un certain nombre de similitudes importantes.
Tout comme en 2003, nous avons de longues files d'attente pour acheter de l'essence, un gouvernement demandant des prêts au FMI, des manifestations de masse, des chars dans les rues protégeant un gouvernement impopulaire, et le radical aymara-indien Felipe Quispe Huanca annonçant son soutien aux blocages de la COB.
Quispe a probablement été la figure la plus importante dans la lutte pour les droits des autochtones tout au long des années 1990 et au début des années 2000. Sa phrase « Je ne veux pas que ma fille soit votre domestique » a changé la politique bolivienne et il a été l'auteur intellectuel de la guerre du gaz de 2003.
Il n'a jamais été membre du MAS et, depuis 2014, il est l'un des critiques indianistes les plus sévères du gouvernement Morales. Pourtant, même parmi ces critiques, il n'est pas le seul à prendre position en faveur des protestations actuelles. Le Dr Félix Patzi, gouverneur autochtone de La Paz et ancien politicien du MAS, a déclaré que Jeanine Áñez finira comme Gonzálo Sánchez de Lozada (« Goni »), le président renversé par les manifestations anti-privatisation de 2003 : « Elle s'est échappée du palais en hélicoptère à cause des conflits qui s'annoncent, les gens en ont assez d'elle et vont se lever ».
Anti-MASisme
Mais il y a une différence importante entre le gouvernement Áñez et celui de Goni : après tout, ce dernier avait remporté une élection démocratique, même si c'était de justesse. Après son éviction, il a été remplacé par son vice-président Carlos Mesa. Áñez est entré en fonction grâce à un coup d'État militaro-policier au nom de la démocratie et de « Dieu », soutenu par la vieille classe moyenne raciste.
La grande majorité de la presse bolivienne a présenté la marche menée par la COB comme une révolte organisée par le parti MAS de Morales, alimentant ainsi le récit du gouvernement putschiste selon lequel les mobilisations de masse visent principalement à déstabiliser le pays en pleine pandémie. Cette même presse a régulièrement qualifié les manifestant·e·s de « sauvages ».
Les principa·les·ux spectateur·rice·s et lecteur·rice·s de ces médias racistes se trouvent dans la classe moyenne traditionnelle des grandes villes et, dans le fief blanc séparatiste de Santa Cruz, y compris des travailleur·euse·s. Ensemble, iels construisent un bloc anti-MAS fort, pour élire « n'importe qui » sauf un gouvernement MAS renouvelé.
Le journaliste Fernando Molina a développé une bonne explication de ce phénomène. La classe moyenne traditionnelle n'a jamais vraiment accepté le président autochtone Morales. Pour elle, la classe moyenne autochtone émergente érodait le « capital éducatif » de l'ancienne classe moyenne privilégiée d'ascendance partiellement espagnole.
Ainsi, les protestations contre Morales ne concernaient pas seulement une supposée « fraude électorale ». C'était une façon euphémique d'exprimer un rejet du pouvoir autochtone, qui devait être remplacé par un bloc de pouvoir centré sur « les forces militaires et policières, le système judiciaire, les médias, les universités et les organisations et institutions des classes moyennes et supérieures ».
Pourtant, étant donné sa propre corruption et ses divisions internes, ainsi que la mauvaise gestion de la COVID-19 par le régime, ce mouvement s'est largement démobilisé au cours des derniers mois. Principal challenger de Morales aux élections d'octobre, l'ancien président Carlos Mesa n'a pas réussi, jusqu'à présent, à rallier suffisamment d'électeur·rice·s blanc·he·s et métis de la classe moyenne à sa propre candidature.
Si des élections démocratiques ont finalement lieu, il tentera d'utiliser la formule du « vote utile », en se présentant comme le seul candidat capable de remporter une élection démocratique contre le MAS. Entre le coup d'État de novembre 2019 et la crise de la COVID-19 qui a débuté en mars dernier, son affirmation est probablement exacte. Mais avec la crise du coronavirus, la réalité sociale en Bolivie a changé.
La COVID-19 et la crise économique
Pendant plus de cent jours de quarantaine, le gouvernement n'a pas acheté de respirateurs et n'a pas informé la population autochtone de la dangereuse pandémie, préférant fermer les stations de radio autochtones. Il n'a donc pas fallu longtemps pour que le système de santé s'effondre. Depuis lors, des milliers de personnes sont mortes dans les rues, dans un pays qui ne compte que 11 millions d'habitant·e·s.
Dans le même temps, la situation économique s'est considérablement détériorée. Au cours des treize années de règne du MAS, la Bolivie a régulièrement affiché la plus forte croissance économique d'Amérique latine. Cela s'est produit sous le ministre de l'économie Luis Arce Catacora, qui est maintenant le candidat du MAS à la présidence. En un peu plus de dix ans, la pauvreté extrême a diminué de plus de moitié, passant de 38,2 pour cent en 2005 à 15,2 pour cent en 2018 ; la pauvreté modérée a également diminué, passant de 60,6 pour cent en 2005 à 34,6 pour cent en 2018. En ce sens, sous Evo Morales et Luis Arce, la Bolivie a connu une décennie dorée.
La population autochtone pauvre qui travaille dans l'économie informelle est celle qui a le plus profité de tout cela. Le gaz naturel a été nationalisé, ce qui a permis des investissements de masse. Des prestations sociales pour les personnes âgées, les mères, les parents et autres ont été créées. Une énorme infrastructure d'écoles, d'universités, d'hôpitaux et de transports publics a été construite, y compris des projets modernes comme les téléphériques urbains reliant La Paz et El Alto.
Une nouvelle génération d'adolescent·e·s autochtones de la classe ouvrière entre pour la première fois à l'université. L'année dernière, le gouvernement du MAS a disposé de ressources financières suffisantes pour commencer à créer un système de soins de santé universel (SUS) afin de faire de l'accès aux soins de santé un droit humain. Il a mis en œuvre son propre modèle économique « social-communautaire », faisant de la Bolivie un pays véritablement indépendant.
Mais plus de la moitié de la main-d'œuvre dépend encore, directement ou indirectement, du travail quotidien dans le « secteur informel ». Après plus de cent jours de quarantaine, sans aucune politique sociale pour soulager leurs souffrances, ce secteur est maintenant soumis à une pression intense. Une partie de la nouvelle classe moyenne autochtone perd maintenant tout ce qu'elle avait. Et les pauvres ont faim, malgré les initiatives de voisinage comme « les pots communs » et « les gens se sauveront eux-mêmes ». Cette terrible situation est à la base des conflits sociaux à venir.
Un test décisif
Face à une nouvelle provocation du régime putschiste, la COB et les mouvements sociaux ont maintenant choisi la voie de la mobilisation de masse, avec les blocages organisés dans tout le pays le 3 août. Il reste à voir s'ils sont maintenant assez forts pour obliger le tribunal électoral à faire preuve d'un degré d'indépendance institutionnelle de base, et à forcer un vote démocratique.
Si le gouvernement putschiste s'en tire en suspendant les élections, il peut s'en tirer à bon compte. Cela signifierait qu'il continuerait à voler ouvertement les entreprises d'État, à persécuter les syndicalistes et les militants autochtones, et à fouler aux pieds les droits démocratiques. Dans les jours et les semaines à venir, nous pouvons nous attendre à d'autres massacres comme en novembre 2019 et au début des années 2000.
La gauche doit être sur ses gardes, prête à dénoncer tous ces abus. Jusqu'à présent, pas un seul groupe ou ONG occidentale de défense des droits humains n'a sérieusement dénoncé le régime putschiste pour ses abus ou les massacres qu'il a commis. Il appartiendra donc au peuple bolivien de se sauver lui-même.
Anton Flaig est l'organisateur du mouvement Wiphala Allemagne et un étudiant en sciences politiques et en sociologie.
Denis Rogatyuk est journaliste à El Ciudadano, écrivain, collaborateur et chercheur pour de nombreuses publications dont Jacobin, Tribune, Le Vent Se Lève, Senso Comune, the GrayZone, et d'autres.
Photo: Noticias al Día