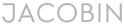Alors que les fortuné·e·s et les nanti·e·s sont resté·e·s à l'intérieur et ont surmonté les pires mois de la pandémie sur leurs vélos Peloton, les travailleur·euse·s du pays sont passé·e·s à la vitesse supérieure. Dix mille travailleur·euse·s de l'équipementier agricole de l'Iowa, de l'Illinois, du Kansas, du Colorado et de la Géorgie se sont mis·es en grève, rejoignant ainsi 1 400 travailleur·euse·s du secteur céréalier dans les usines de Kellogg au Nebraska, au Michigan, au Tennessee et en Pennsylvanie, ainsi que 1 100 mineur·euse·s chez Warrior Met Coal en Alabama et des infirmier·ère·s de New York et du Massachusetts. Des milliers d'autres attendent dans les coulisses, qu'il s'agisse de travailleur·euse·s universitaires, de travailleur·euse·s de la santé chez Kaiser Permanente en Oregon, en Californie et à Hawaï, ou de travailleur·euse·s du cinéma et de la télévision dans l'industrie du divertissement, qui ont évité la grève après avoir menacé de quitter le travail et ont conclu un accord de principe qui sera maintenant soumis au vote.
Ce n'est pas tout. Les chauffeur·euse·s de taxi de la ville de New York ont fait tourner au ralenti leurs emblématiques voitures jaune moutarde et campé devant l'hôtel de ville depuis plus d'un mois, organisant une veille de protestation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Celle-ci s'est transformée en grève de la faim la semaine dernière. La grève de la faim des membres et des sympathisant·e·s de la New York Taxi Workers Alliance a eu lieu avant la date limite de modification du budget trimestriel le 31 octobre. Jusque-là, le maire Bill de Blasio pouvait, s'il le souhaitait, ajouter une garantie de prêt pour réduire les paiements mensuels sur les dettes écrasantes que les chauffeur·euse·s ont accumulées (en moyenne un demi-million de dollars par chauffeur·euse) en raison des systèmes de licences prédatrices.
Quel que soit le nom que l'on donne à ce regain marqué de militantisme ouvrier, une chose est claire. En général, et au niveau individuel, les travailleur·euse·s sont plus confiant·e·s qu'iels ne l'ont été depuis longtemps, et iels utilisent à leur avantage la crise qui se présente à elleux. Les membres de la vaste « classe des receveur·euse·s d'ordre » utilisent ce nouveau levier pour exiger de meilleurs salaires, alors que les employeur·euse·s s'efforcent de pourvoir les postes vacants sur un marché du travail tendu, et que la pandémie continue de faire rage dans le pays. Il ne s'agit pas seulement de grandes grèves qui font les gros titres. L'audace et l'assurance croissantes des travailleur·euse·s se manifestent d'autres manières notables.
« Nous assistons à une opportunité unique pour de nombreux·ses travailleur·euse·s qui ont été en première ligne d'une pandémie mondiale et qui reconnaissent que les employeur·euse·s ont du mal à embaucher », a déclaré Johnnie Kallas, directeur de projet du Labor Action Tracker de l'Université Cornell, une base de données en ligne qui documente les actions syndicales et les grèves, quelle que soit leur taille.
« Par exemple, depuis la fin septembre, nous avons recensé six grèves distinctes de chauffeur·euse·s de bus syndiqué·e·s et non syndiqué·e·s, impliquant entre 20 et 200 travailleur·euse·s », ajoute M. Kallas. « La quasi totalité de ces grèves comportent des revendications liées à une augmentation de salaire. Des préoccupations en matière de santé et de sécurité ont également été exprimées par les grévistes. »
Pendant ce temps, dans le cadre de ce que certain·e·s appellent la « grande démission » et que d'autres décrivent comme une « grève générale non officielle », quelque 30 millions de travailleur·euse·s américain·e·s ont quitté leur emploi de janvier à août, un reproche collectif étonnant, exprimé à un niveau individuel, contre les détériorations fréquentes des emplois peu rémunérateurs et dévalorisants.
Stephanie Luce, professeure d'études du travail à la City University de New York, note que les grèves s’étendent au-delà des autorisations officielles de grève émises par les syndicats. « Nous pourrions voir beaucoup plus d'arrêts de travail qui ne sont pas des grèves formelles déclarées par les syndicats, ou des grèves formelles dans des lieux de travail plus petits, et des actions de travail informelles. »
« Nous devrions tenir compte de l'éventail des actions sur le lieu de travail auxquelles se livrent les travailleur·euse·s pour protester contre leurs conditions, des grèves formelles aux ralentissements de travail, aux arrêts de maladie et aux démissions. Les travailleur·euse·s ont toujours eu recours à un éventail de tactiques qui devraient être considérées comme faisant partie de la grève. »
Et pourquoi ne pas jeter l'éponge ? Le.la travailleur·euse moyen·ne est plus productif·ve que jamais, mais iel voit son salaire réel stagner depuis des décennies, alors que le coût de la vie augmente et que la plus grosse part des profits est siphonnée par celleux au sommet. Le fait que la richesse des 1 pour cent a explosé au cours de la pandémie, n'a fait que rendre plus clair le fait que nous jouons tou·te·s à un jeu truqué. Alors que les travailleur·euse·s luttent pour garder la tête hors de l'eau, iels ont vu la rémunération des PDG atteindre son point culminant, augmentant de 19 pour cent en 2020, soit 24,2 millions de dollars en moyenne, selon une étude réalisée en août par l’Economic Policy Institute.
Certain·e·s ont canalisé leur mécontentement dans les affres de la négociation collective et se sont affairé·e·s sur le périmètre des piquets de grève. Or, si les travailleur·euse·s ont effectivement mis la pression sur les patron·ne·s, la flamme du militantisme ouvrier n'est pas encore un chalumeau capable de déclencher des conflagrations d'arrêts de travail dans tout le pays.
De janvier 2021 à aujourd'hui, il y a eu 198 grèves. 53 d’entre elles, impliquant environ 28 200 travailleur·euse·s, ont eu lieu au cours du seul mois d'octobre, selon le Labor Action Tracker. En revanche, le Bureau américain des statistiques du travail, qui ne recense que les arrêts de travail impliquant au moins 1 000 travailleur·euse·s, estime le nombre de grèves à 12 depuis janvier 2021, sur la base de données s’étendant jusqu'à septembre 2021.
Il convient de réfléchir sur la réalité suivante. Bien que le mécontentement alimentant la recrudescence actuelle des grèves et des manifestations soit incroyablement important, cette recrudescence fait toujours pâle figure en comparaison des 485 000 travailleur·euse·s qui ont fait grève en 2018, et des 425 000 participant·e·s à une vague de grèves en 2019, impliquant des enseignant·e·s dans des États allant de la Virginie-Occidentale à l'Arizona, ainsi que des travailleur·euse·s dans des usines automobiles et des hôtels. Remontons encore plus loin, jusqu'en 1971, où plus de 5 000 arrêts de travail impliquant plus de 3 000 000 de travailleur·euse·s ont eu lieu. La comparaison avec les chiffres de grève actuels fait ressortir encore davantage la réalité de la situation des travailleur·euse·s. Le fait que des dizaines de milliers d’entre elleux se défendent en 2021 est important, mais il y a environ 14 millions de travailleur·euse·s syndiqué·e·s rien qu'aux États-Unis, selon le rapport annuel 2021 du Bureau of Labor Statistics. Bref, c'est un grand pays et il nous reste beaucoup de chemin à parcourir.
« Je pense que l'expression "vague de grève" est parfois utilisée indûment, car elle dépend de ce que vous comparez », a déclaré Kallas. « Nous savons aussi que les changements dans notre économie ont rendu la grève beaucoup plus ardue depuis les années 1980, d'où l'importance de contextualiser ces comparaisons historiques. »
Nous devons être capables de faire deux choses simultanément. Il faut identifier et cultiver les passions chez les masses laborieuses de l'Amérique qui ont fait de cette conjoncture un moment privilégié, mais être lucides aussi sur les défis profonds qui l’empêchent de se transformer en mouvement. Par exemple, alors que citer un sondage Gallup de septembre selon lequel plus de 68 pour cent des Américain·e·s approuvent les syndicats est devenu une génuflexion journalistique routinière, le nombre d’efforts organisationnels nouveaux sur les lieux de travail ne reflète pas ces tendances changeantes de l'opinion publique. Cela devrait à tout le moins tempérer notre fébrilité quant au potentiel d'une nouvelle poussée ouvrière impliquant des millions de travailleur·euse·s, et pouvant mettre à genoux les patron·ne·s et notre système économique truqué. Nous n'en sommes pas encore là.
La création d'un élan est cruciale pour la construction d'un mouvement, et les grèves réussies sont effectivement contagieuses, encourageant les travailleur·euse·s ailleurs à agir sur leur propre lieu de travail. Mais « une grève ratée qui se termine par le remplacement permanent des grévistes par des briseur·euse·s de grève, peut semer la peur et le désespoir dans les communautés et les industries », a écrit Shaun Richman, directeur de programme de la Harry Van Arsdale Jr. School of Labor Studies au SUNY Empire State College, dans le magazine In These Times. En somme, autant les nouvelles grèves et l'enthousiasme du public pour les luttes des travailleur·euse·s peuvent aider à relever le mouvement ouvrier, autant les grèves ratées et l'engagement public faiblissant envers ces mêmes luttes peuvent pousser le mouvement plus loin dans la mauvaise direction. Même si le militantisme des travailleur·euse·s s'accroît, ces dernier·ère·s ont un chemin délibérément étroit à parcourir jusqu'à la victoire, façonné par des décennies, voire des siècles, de lois anti-ouvrières et de culture antisyndicale. C'est pourquoi, dans le même article d’In These Times, Richman plaide en faveur d'une réforme du droit du travail, y compris le droit de reprendre le travail après une grève. Rappelez-vous ce jour fatidique de 1981 où Ronald Reagan, chef des briseurs de grève, a licencié plus de dix mille contrôleur·euse·s aérien·ne·s. C'est aussi la raison pour laquelle de nombreux·ses travailleur·euse·s, dirigeant·e·s syndicaux·ales et défenseur·euse·s des droits des travailleur·euse·s ont fait pression pour l'adoption de la loi sur la protection du droit d'organisation, ce qui, selon elleux, ouvrirait des voies permettant aux travailleur·euse·s de prendre le militantisme d'aujourd'hui et de lui donner des formes d'organisation des travailleur·euse·s vraiment efficaces.
Si de telles modifications à la loi du travail américaine avaient lieu du jour au lendemain, elles auraient entre autres d'énormes conséquences pour les mineur·euse·s de l'Alabama qui sont en grève depuis huit mois et ont vu des briseur·euse·s de grève remplacer certain·e·s travailleur·euse·s et renverser des piqueteur·euse·s avec leurs voitures. De même, les infirmier·ère·s du Massachusetts sont en grève depuis bientôt huit mois et leur employeur texan, Tenet Healthcare, refuse de réembaucher les grévistes bien qu’il ait réalisé 448 millions de dollars de profit au troisième trimestre.
« Les moyens de pression pour gagner diffèrent manifestement selon les secteurs et les entreprises », a déclaré Peter Olney, ancien directeur de l'organisation de l'International Longshore and Warehouse Union, en évoquant les infirmier·ère·s de St. Vincent et une journée d'action nationale qu'il coordonne avec les Socialistes démocrates d'Amérique. « Tenet possède plus de 450 établissements et vient d'encaisser 2,4 milliards de dollars pendant la pandémie. L’entreprise déborde de liquidités et fait une déclaration politique aux syndicats qui osent la défier. La voie du règlement serait la solidarité syndicale, mais seuls 30 établissements sont syndiqués à l'échelle nationale, et l’Union Internationale des employés de service (UIES) a conclu un accord national “d'organisation" avec Tenet, interdisant toute solidarité. »
Si Olney se félicite de la nouvelle attitude militante et du désir des travailleur·euse·s d'obtenir de meilleurs emplois, il rappelle simplement que ce désir seul « ne peut pas surmonter les réalités préexistantes de la faiblesse et de la léthargie des syndicats. L'organisation de l'énorme secteur privé non syndiqué reste la clé. »
Stephanie Luce, de la City University de New York, est du même avis. « On a beau parler de la montée en puissance des travailleur·euse·s dans un marché du travail tendu, ces longues grèves montrent l'énorme déséquilibre de pouvoir qui subsiste entre l'employeur·euse moyen·ne et le.la travailleur·euse moyen·ne », a-t-elle déclaré. « Les employeur·euse·s ont beaucoup plus de droits, de ressources, d'avocat·e·s et de pouvoir politique que les travailleur·euse·s, ce qui signifie que malgré leurs cris d'impuissance, l'employeur·euse moyen·ne sera capable de survivre au syndicat moyen sur un piquet de grève. »
Depuis avril, deux douzaines de travailleur·euse·s du terminal pétrolier de la United Metro Energy Corporation à Brooklyn, New York, sont en grève après que des négociations de plus de deux ans entre la section 553 des Teamsters et le milliardaire John Catsimatidis aient échoué. Après six mois de grève, huit travailleur·euse·s ont reçu des lettres de remplacement définitif. Les Teamsters avaient déjà déposé une plainte auprès du National Labor Relations Board pour le ciblage présumé de militant·e·s syndicaux·ales par l'entreprise, et ont porté de nouvelles accusations à mesure que l'enquête progressait.
Les deux douzaines de travailleur·euse·s en grève à l'origine ne sont plus que 14 aujourd'hui, car beaucoup d'entre elleux ont accepté des emplois ailleurs lorsqu'iels ont reçu des lettres de remplacement permanent, selon le gréviste Ivan Areizaga, 56 ans, un opérateur de terminal qui travaille pour cette société depuis bientôt six ans.
« Je me suis consacré à l'entreprise. J'ai travaillé de 22 heures à 7 heures du matin. Celle-ci n’a même pas tenu compte du fait que j'ai une famille. Je veux avoir un week-end avec mes enfants », a-t-il dit. « La seule fois où j'ai pris congé, c'est quand ma mère est décédée. Trois jours après, je suis revenu au travail, je n'ai jamais manqué un jour et j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé. »
En plus des longues heures de travail, M. Areizaga a découvert que la norme salariale industrielle pour son poste est de 37 dollars l’heure, alors qu’il en gagne 27. Père de trois enfants, il a commencé à songer à la retraite et à une pension. Il s'est donc joint à ses collègues et a fondé un syndicat, saisissant la perspective d'une stabilité financière.
« J'ai 56 ans. Combien d'années dois-je travailler pour gagner décemment ma vie et subvenir aux besoins de ma famille ? » s'est-il demandé.
« Autant le syndicat a le droit de grève, autant nous avons le droit, en vertu de la loi fédérale sur le travail, de remplacer les employé·e·s de façon permanente pour nous permettre de servir nos client·e·s », a déclaré M. Catsimatidis au journal local The City, précisant que la dictature des employeur·euse·s est en grande partie une offensive légale.
Peu après avoir déclenché la grève, M. Areizaga a déclaré que l'entreprise avait réduit ses prestations de santé. Il a raconté l'expérience de son fils qui souffre de diabète, appelant de son université en Caroline du Nord, paniqué parce qu'il ne pouvait pas avoir accès à ses médicaments. « Papa, qu'est-ce qui se passe ? », lui a demandé son fils. « Je ne peux pas obtenir mes médicaments. »
« Ce que nous demandons, il l'a dans sa poche arrière », a déclaré M. Areizaga à propos du milliardaire Catsimatidis. Nous étions là durant la pandémie quand tout le monde était à la maison ; nous étions là pour subvenir aux besoins de New York. »
M. Areizaga et ses collègues approvisionnent New York en mazout, en diesel et en essence, ce qui permet de garder au chaud les écoles, les hôpitaux et le métro de la ville. Iels sont également responsables de l'approvisionnement des stations-service locales. Ces personnes et leur travail sont essentiels pour la ville et ses habitant·e·s. Et pourtant, le droit du travail existant permet aux patron·ne·s de dissocier le travail et le.la travailleur·euse plus facilement qu'il ne devrait, ce qui leur permet de le.la remplacer par quiconque est prêt·e à faire le boulot, tout en ignorant les besoins et les préoccupations exprimés par des employé·e·s comme M. Areizaga.
John Catsimatidis de la United Metro Energy Corporation n'a pas répondu à une demande de commentaire.
« Nous n'abandonnons pas. Nous avons déjà beaucoup perdu », a conclu M. Areizaga.
Si nous voulons que Striketober soit plus qu'un moment bref et prometteur dans le temps, nous ne devons pas oublier des travailleur·euse·s comme M. Areizaga, les mineur·euse·s de Warrior Met Coal, ou les infirmier·ère·s de l'Hôpital Saint-Vincent. Nous devons tou·te·s faire ce que nous pouvons pour les aider à gagner leurs luttes, et nous devons avoir une stratégie concertée pour aborder ou supprimer les obstacles systémiques qui rendent la victoire si difficile.
Striketober peut très bien n'être qu'un hashtag viral, mais le militantisme croissant des travailleur·euse·s qu'il traduit existe bel et bien, se répandant comme de la poudre de perlimpinpin jusqu'au plus petit nombre de travailleur·euse·s qui s’unissent pour fonder des syndicats et faire grève. Ce qui reste à voir, ce sont les efforts pour reconstruire les organisations de classe à une échelle encore plus massive, pour un rééquilibrage durable du pouvoir dans la lutte du plus grand nombre contre la minorité prédatrice.
Luis Feliz Leon est rédacteur et organisateur de Labor Notes. Suivez-le sur Twitter : @Lfelizleon.
Maximillian Alvarez est rédacteur en chef du Real News Network.