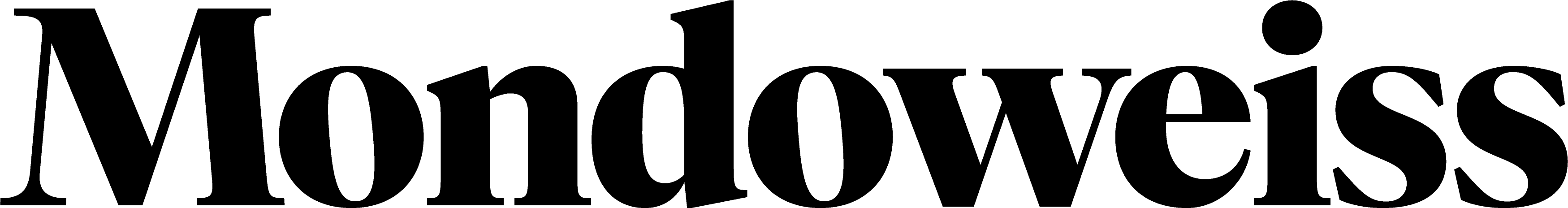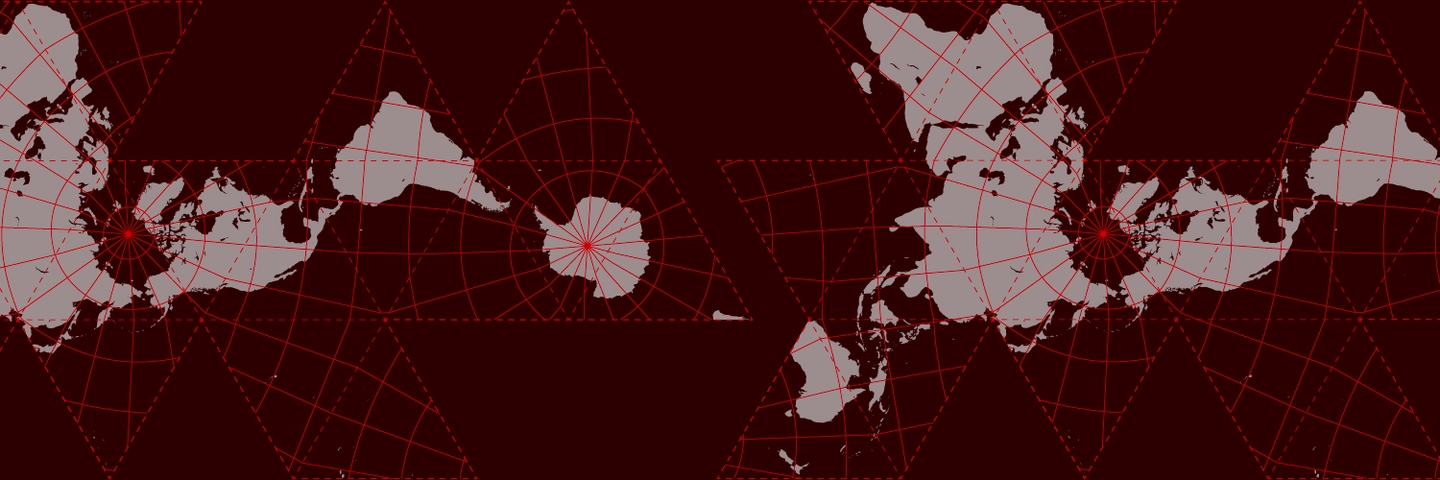Cet article est republié de Guyaweb via Mediapart, partenaire de la Revue
Créé à Mana en 1935, ce système a été validé par l’État en 1949, après la départementalisation de la Guyane, en finançant publiquement le placement des enfants et le développement des homes.
Le livre de la journaliste Hélène Ferrarini, Allons enfants de la Guyane, publié en septembre, a jeté une lumière crue sur cette part enfouie de l’histoire guyanaise. Une histoire toujours en marche puisqu’un dernier home subsiste à Saint-Georges-de-l’Oyapock et accueille une soixantaine d’enfants de Trois-Sauts, village dépourvu de collège.
Home indien de Saint-Laurent-du-Maroni, 1964. © Photo AGFMM
L’enquête de notre consœur pose les premiers jalons d’un travail mémoriel. Sur les 2 000 enfants passés par les homes, « une quarantaine d’anciens pensionnaires a témoigné dans le livre, mais il reste beaucoup de choses à révéler », explique Hélène Ferrarini lors d’un débat organisé le 10 décembre au cinéma Eldorado, à Cayenne.
« Chaque home, d’Iracoubo, Sinnamary, Maripasoula…, mériterait des recherches spécifiques car il n’y en a pas tant que ça, mis à part le travail pionnier de Françoise Armanville », publié il y a dix ans, estime-t-elle.
Mais « depuis la sortie du livre, il y a un effet boule de neige, un besoin de dire la vérité, de conscientisation et de courage pour parler. Les choses changeront à condition que les anciens pensionnaires décident de raconter », appuie le juriste Alexis Tiouka, engagé dans la reconnaissance des peuples autochtones de Guyane.
Un besoin de libération de la parole pressant, alors que les témoins directs disparaissent petit à petit, comme Jean Appolinaire, figure kalin’a décédée en juin 2021, dont l’histoire fait l’objet d’un chapitre du livre.
« Très difficile de parler de ce que l’on a vécu »
Ce soir-là, autour d’Hélène Ferrarini, d’ancien·nes pensionnaires racontent comment elles et ils ont été arraché·es à leur famille et flanqué·es dans les internats catholiques.
Comme Alexis Tiouka, placé à l’âge de 6 ans : « Dans les homes, il fallait se courber devant les religieux, c’était du formatage. Nos cheveux étaient rasés comme les militaires alors que pour nous, Kalin’a, ils sont une fierté, une spiritualité. C’est très important les cheveux dans notre culture. Toutes ces règles étaient imposées. Nous étions déconsidérés et humiliés sans cesse. C’est très difficile de parler de ce que l’on a vécu. »
« Ce qui m’a fait le plus de peine, c’est de ne plus pouvoir parler ma langue », réagit Éléonore « Kadi » Johannes, envoyée au pensionnat catholique à 4 ans. « Les homes ont conditionné le reste de mon existence. Ce n’est pas un hasard si je suis une militante toujours en colère aujourd’hui. C’est une question de survie », poursuit la porte-parole du collectif Or de question.
Si ces militant·es de la cause amérindienne parlent, « c’est pour ne pas répéter le même schéma qui porte aujourd’hui d’autres dénominations : famille hébergeante, internat », insiste Alexis Tiouka. Peut-être est-ce dû au contexte de la soirée, mais parmi les prises de parole de l’assistance, une voix détonne. Celle de Jean-Paul Fereira, maire d’Awala-Yalimapo et premier vice-président de la Collectivité territoriale. Né dans les années 1970, il compte parmi la dernière génération à avoir fréquenté le home de Mana avant sa fermeture dans les années 1980.
Le roucou, comme d’autres liens culturels, était interdit aux pensionnaires des homes. Seul le hamac était autorisé. © Photo Boris R-Thébia
Sollicité pour le livre, il ne s’était alors jamais exprimé sur son expérience et apporte dans le décor feutré du cinéma un témoignage précieux.
« Quand on rentrait dans le pensionnat, un numéro nous était attribué. J’avais le 11. Je m’en souviens encore aujourd’hui. Il y a eu des sévices corporels, sexuels, mais beaucoup de personnes ne veulent pas en parler. Même si le home est fermé, c’est un sujet d’actualité car on le subit dans notre tête, dans nos veines, dans notre chair. Je remercie Hélène Ferrarini pour ce livre mais déplore que lorsqu’il s’agit des peuples autochtones, ce sont souvent les autres qui parlent pour nous, qui font pour nous. »
« Cette histoire est douloureuse, traumatique et tabou », explique Boris Thébia, photographe documentaire guyanais expatrié au Canada depuis sept ans. Là-bas, les populations autochtones ont subi la même assimilation forcée par l’éducation, à grande échelle (150 000 enfants placés). Une histoire qui résonne avec celle des homes de Guyane que Boris Thébia souhaite faire connaître davantage. Car au Canada, « c’est un vrai sujet de société » depuis que l’État a engagé un travail de reconnaissance et de réparations en 2009.
« Le récit guyanais pourrait être transposé aux États-Unis, en Australie, en Scandinavie, partout où les populations autochtones ont vécu cela. Dans tous ces pays, des Commissions vérité et réconciliation ont été engagées pour réparer ce traumatisme. Pas en France », explique le professeur de droit Jean-Pierre Massias, président de l’Institut Louis-Joinet, spécialisé dans la justice transitionnelle. « L’une des suites du livre, pour surmonter le traumatisme, pourrait être un programme de recherche universitaire et une Commission vérité et réconciliation », poursuit-il.
Au Canada (ici en 1940 dans l’État du Manitoba), les enfants étaient placés dans les « residential school ». 150 000 ont connu ce système d’assimilation forcée, selon les travaux du gouvernement menés entre 2009 et 2015. © Photo Library and Archives Canada
« Admettre que cela s’est passé en France »
En partenariat avec le Grand Conseil coutumier (GCC) et de nombreuses organisations autochtones (Foag, Onag, JAG, Copag), Jean-Pierre Massias est venu amorcer en Guyane ce processus juridique de reconnaissance des violences subies. Formée d’experts (juristes, psychiatres, historiens, victimes, anthropologues), cette commission aurait pour mission d’« étudier les violations des droits humains, recenser les violations, écouter les victimes, déterminer les responsabilités, proposer des mesures de réparation et de réorganisation de la société pour ne plus répéter les mêmes faits », décline le juriste passé par la Palestine ou l’Afrique. « Ce sont les quatre principes de la Commission vérité et réconciliation qui n’est pas là pour condamner un État mais pour obtenir réparation, pour la dignité. »
Parmi les réparations potentielles, les symboliques – « présenter des excuses, ériger des monuments, restituer des objets spoliés » – sont les plus usitées. Les financières, « difficiles à quantifier et très chères », sont peu employées, estime d’expérience Jean-Pierre Massias.
« On pourrait aller jusqu’à la reconnaissance de l’identité culturelle. Donner aux autochtones la garantie de la sauvegarde de la langue et de la culture, donc refonder le système en proposant des réformes de société, notamment sur l’éducation », espère le juriste.
Pour l’instant, la Guyane est loin de cette reconnaissance. Un séminaire a été organisé par le Grand Conseil coutumier mi-décembre, pour aborder notamment le projet de Commission vérité et réconciliation (CVR). Mais son budget a été gelé par la préfecture, organe de tutelle de l’instance représentative.
Une coupe de « 15 000 euros », d’après Christophe Yanuwana Pierre, son vice-président. Et pas à cause de caisses vides. Selon Christophe Pierre, il restait « 85 000 euros de budget au GCC début décembre sur un total de 195 000 pour 2022 ». Depuis, signe d’une tutelle accrue, le budget (25 000 euros) du rassemblement de Prospérité des 17 et 18 décembre a également été suspendu.
Danemark, Finlande, Canada, États-Unis ont tous activé cet « instrument de régénération de la démocratie qu’est la CVR », énonce Jean-Pierre Massias, « pas la France ». Une commission « assez similaire » a bien eu lieu lors du scandale des « Réunionnais de la Creuse », ces enfants relevant de l’aide sociale à l’enfance transférés sans leur consentement dans les départements hexagonaux sujets à l’exode rural, mais les « exemples restent peu nombreux », affirme le juriste. « Le blocage n’est pas juridique ou financier pour mettre cela en place, mais psychologique : admettre que cela s’est passé en France. »
Pour parvenir à cette reconnaissance symbolique et historique de ce qui s’apparente à un crime colonial, le récit guyanais doit être « davantage structuré, en invitant par exemple l’Église à s’exprimer sur le sujet », explique le président de l’Institut Joinet, venu distiller une méthode et répondre aux questions : à quoi sert une CVR, comment la mettre en place, quelle mission aurait-elle ? Des interrogations qui ont fait l’objet de débats et de travaux lors d’un séminaire sur le thème « Autochtones et école, réparer l’injustice ? », organisé le 13 décembre à l’université de Guyane.
Tout un après-midi, le GCC, réuni en assemblée spéciale, a posé les premiers jalons pour la création d’une Commission vérité et réconciliation. Un compte-rendu de ces travaux est en cours d’élaboration. Il sera la première étape vers l’ouverture d’une CVR.
« Il faut ensuite lancer une enquête de faisabilité, sur le terrain, pendant trois mois. Puis un à deux ans de travail pour auditionner les témoins, établir les responsabilités et proposer des mesures réparatrices à consigner dans un rapport », détaille Jean-Pierre Massias. Un projet qui nécessite un financement pour constituer une équipe d’experts, une appropriation par les Amérindiens et une volonté politique pour le lancer.
Pour ce faire, un travail de lobbying auprès de parlementaires est déjà engagé. D’ailleurs, le séminaire a correspondu au déplacement en Guyane de la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui s’est notamment rendue à Camopi. Nous confirmant avoir été interpellée de manière informelle sur les homes et le projet de commission, la présidente de l’Assemblée souhaite prendre le sujet « à bras-le-corps ».
« C’est un défi très actuel de former et scolariser des jeunes enfants de ces territoires isolés sans pour autant annihiler leur culture et leur histoire. Au-delà de l’enseignement, cette question touche à l’intégration et au respect des populations autochtones en Guyane et partout en France », a-t-elle expliqué.
Une parole rare des « autorités », alors que ni État ni préfecture n’ont eu un mot depuis la sortie du livre et ne se sont déplacés au séminaire auquel ils étaient conviés. Notre demande d’interview du sous-préfet aux communes de l’intérieur a également été refusée par le représentant local de l’État.
« Il faut braquer la justice, récupérer notre dignité », tonne Christophe Yanuwana Pierre, porte-parole des Jeunesses autochtones, dont la mère et la grand-mère sont d’anciennes pensionnaires des homes.
Une manière de pousser la société civile à agir sans attendre l’assentiment de l’État, alors qu’« il est légitime d’ouvrir une Commission vérité et réconciliation en Guyane car l’histoire des homes est une bombe à retardement dans la société. Elle tient un rôle dans les violences intracommunautaires, dans les suicides, du fait de la déstabilisation culturelle », considère Jean-Pierre Massias. « Et le déclenchement d’une telle commission pourrait ouvrir sur d’autres expériences traumatisantes comme l’esclavage, le bagne… et permettre à d’autres communautés de Guyane de s’émanciper. »
« Ce sont souvent les populations minorisées qui sont avant-gardistes, relève le député Jean-Victor Castor (groupe GDR), présent lors de la projection à l’Eldorado. Vous êtes en train de vous unir. Peut-être que le combat des autochtones va permettre une émancipation plus générale ? »
Les homes amérindiens seraient ainsi le point de départ d’une question plus large : celle de l’assimilation ou de la domination du monde occidental sur les peuples autochtones. D’où l’intérêt d’une Commission qui permettrait de replacer cet événement dans quelque chose de plus systémique.
L’éducation, pierre angulaire
Car, même si les homes ferment définitivement – le dernier en activité, celui de Saint-Georges, devrait l’être, avec l’ouverture en septembre 2023 de la cité scolaire de la commune, nous affirme la collectivité territoriale de Guyane (CTG) –, « l’histoire ne s’arrête pas et un continuum sur les difficultés d’intégration, de violence, de pauvreté se poursuit », analyse Jean-Pierre Massias, qui prône des réformes profondes du système, notamment éducatif.
Pierres angulaires des homes, la scolarisation des enfants autochtones et leur hébergement sont toujours des sujets cruciaux en 2022. D’après Libération, environ 300 élèves des communes isolées sont actuellement logés dans des internats ou des familles hébergeantes, le plus souvent sur le littoral et dès la sixième, faute d’établissement de proximité. Un fonctionnement loin d’être idéal et générateur de décrochage scolaire.
Une refondation de la politique des familles hébergeantes est d’ailleurs en cours depuis un an à la CTG pour pallier les nombreux dysfonctionnements de ce système.
Voilà pourquoi, au-delà de la reconnaissance par l’État de ses violences, les questions éducatives pourraient tenir un rôle central dans les mesures de non-répétition proposées par la Commission vérité et réconciliation.
« L’éducation est un droit de l’Homme en soi et permet la réalisation des autres droits », rappelle Alexis Tiouka dans la préface d’Allons enfants de la Guyane. Un parti pris similaire à celui du représentant de l’Unicef en Guyane, l’agence onusienne dédiée à l’enfance, qui a participé au séminaire organisé à l’université.
D’après un bulletin de l’Observatoire des pratiques linguistiques daté de 2017, une vingtaine de langues de « première scolarisation » sont usitées en Guyane. Depuis 1998, le dispositif d’intervenant en langue maternelle permet d’enseigner dans ces langues régionales. Un des rares efforts d’adaptation de l’institution éducative aux élèves autochtones.
« L’éducation est imbriquée dans les questions de protection de l’enfance ou des familles hébergeantes, car l’hébergement en Guyane, du fait de l’enclavement, est un facteur d’accès à l’éducation et de réussite éducative. C’est une des particularités ici avec les langues », constate David Chenu.
Lors du séminaire, il a animé un atelier sur les réalités des élèves autochtones : hébergement sur le littoral, transports, mobilité, lien famille-école. De 60 à 70 personnes y ont participé, contre 30 pour l’atelier CVR, signe d’un intérêt prononcé pour ces sujets de la vie quotidienne.
Plusieurs constats ont été dressés à l’issue de cet atelier, dont un compte-rendu doit être rédigé dans les prochaines semaines. Ils ne sont pas nouveaux et demandent en premier lieu le rapprochement de l’institution scolaire. « Ce serait pertinent à Trois-Sauts par exemple où il y aurait un potentiel de 150 futurs collégiens », souligne David Chenu.
En second lieu a émané la nécessité de valoriser la culture amérindienne sur le littoral « avec des pistes d’idées comme multiplier les référents amérindiens dans les établissements scolaires où sont accueillis les élèves autochtones. Ce référent permet de créer un lien, d’aider à comprendre les mécanismes scolaires, parle la même langue, évite les blocages et à terme le décrochage », raconte le délégué de l’Unicef.
Seul un établissement de l’île de Cayenne posséderait ce type de poste, d’après David Chenu. Une information que nous n’avons pas pu croiser avec le rectorat.
Troisième constat : la nécessité d’augmenter la participation des enfants et des familles dans les dispositifs en place pour une meilleure compréhension et adhésion.
« Il faut les impliquer dans la réflexion sur ce qui pourrait changer, que les règles ne soient pas uniquement fixées par les institutions. Cela permet de créer plus de liens, de mettre en place des mécanismes d’urgence s’il y a des soucis par exemple », détaille David Chenu.
Davantage de transparence a également été demandée lors de cet atelier pour permettre à chacun de comprendre les réalités des enfants et des familles, « et éviter que des jeunes se retrouvent à la rue quand les internats ferment le week-end ou pendant les vacances », souligne le représentant de l’Unicef.
« Il y a beaucoup à faire en Guyane mais on pourrait s’inspirer pour le désenclavement de ce qui a été fait en Polynésie par exemple, où les îles sont éparpillées sur la surface de l’Europe. La réponse là-bas, ce sont des collèges multisites, c’est une idée. »
L’enjeu est de taille : avoir des établissements de proximité capables de faire un enseignement adapté afin que les homes ne soient pas juste remplacés par une structure portant un autre nom mais produisant les mêmes effets.