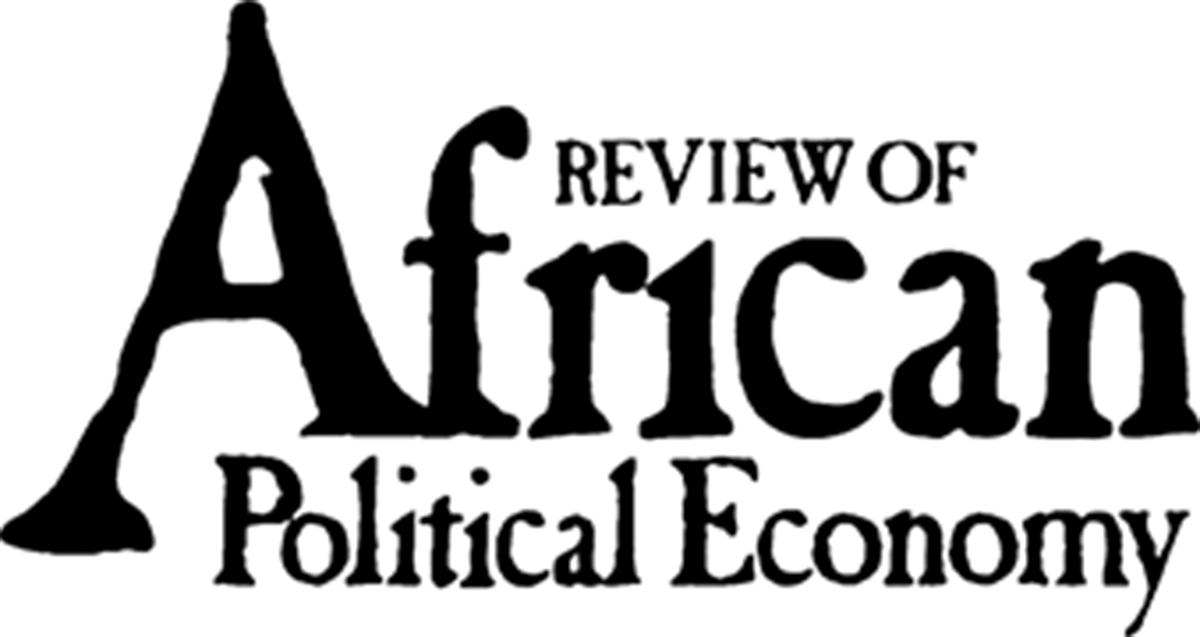Jamais je n'aurais imaginé que l'opposition à un prêt du Fonds monétaire international (FMI) au Kenya serait considérée par les autorités kényanes comme un acte criminel. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé au début du mois d'avril, lorsque le militant Mutemi Kiama a été arrêté et inculpé d'« abus de gadgets numériques », d'« atteinte à la présidence », de « trouble à l'ordre public » et d'autres infractions formulées en termes vagues. L'arrestation de Mutemi a été provoquée par sa publication sur Twitter d'une image du président Uhuru Kenyatta avec la légende suivante : « Ceci a pour but de notifier au monde entier... que la personne dont la photo et les noms apparaissent ci-dessus n'est pas autorisée à agir ou à effectuer des transactions au nom des citoyens de la République du Kenya et que la nation et les générations futures ne devront pas être tenues responsables des pénalités liées aux mauvais prêts négociés et/ou contractés par lui. » Il a été libéré grâce à une caution en espèces de 500 000 shillings kényans avec une ordonnance lui interdisant d'utiliser ses comptes sur les réseaux sociaux ou de parler des prêts liés à la COVID-19.
Mutemi fait partie des plus de 200 000 Kényan·e·s qui ont signé une pétition adressée au FMI pour qu'il mette fin à un prêt de 257 milliards de shillings kényans (2,3 milliards de dollars américains) accordé au Kenya, prétendument obtenu pour protéger le pays contre l'impact économique négatif de la COVID-19. Le Kenya n'est pas le seul pays dont les citoyen·ne·s se sont opposé·e·s à un prêt du FMI. Des manifestations contre les prêts du FMI ont eu lieu dans de nombreux pays, notamment en Argentine, où la population est descendue dans la rue en 2018 lorsque le pays a contracté un prêt de 50 milliards de dollars américains auprès du FMI. En 2016, les autorités égyptiennes ont été contraintes de baisser les prix du carburant à la suite de manifestations contre une décision, soutenue par le FMI, de supprimer les subventions au carburant. Des manifestations similaires ont également eu lieu en Jordanie, au Liban et en Équateur ces dernières années.
Pourquoi les citoyen·ne·s d'un pays s'opposeraient-iels à un prêt accordé par une institution financière internationale telle que le FMI ? Pour les Kényan·e·s qui ont survécu (ou à peine réchappé) aux programmes d'ajustement structurel (PAS) du FMI et de la Banque mondiale dans les années 1980 et 1990, la réponse est évidente. Les PAS étaient assortis de conditions strictes, qui ont entraîné de nombreux licenciements dans la fonction publique et la suppression des subventions pour les services essentiels, tels que la santé et l'éducation, ce qui a conduit à des niveaux croissants de difficultés et de précarité, en particulier parmi les groupes à revenus moyens et faibles. Les pays africains soumis aux PAS ont connu ce que l'on appelle souvent « une décennie de développement perdue », les mesures de rigueur ayant bloqué les programmes de développement et réduit les opportunités économiques.
En outre, les pays africains emprunteurs ont perdu leur indépendance en matière de politique économique. Étant donné que les prêteurs, tels que la Banque mondiale et le FMI, décident de la politique économique nationale - par exemple, en déterminant des éléments tels que la gestion budgétaire, les taux de change et la participation du secteur public à l'économie - ils sont devenus les autorités politiques et décisionnelles de facto des pays qui ont contracté leurs prêts. C'est pourquoi, pendant la majeure partie des années 1980 et 1990, l'arrivée d'une délégation de la Banque mondiale ou du FMI à Nairobi a souvent alarmé les Kényan·e·s.
À l'époque (au lendemain d'une hausse des prix du pétrole en 1979 qui a vu la plupart des pays africains voir leurs factures d'importation augmenter et leurs recettes d'exportation diminuer), les dirigeant·e·s de ces institutions financières internationales étaient autant craint·e·s que le président autoritaire kényan, Daniel arap Moi, car d'un trait de plume, iels pouvaient dévaluer la monnaie kényane du jour au lendemain et faire licencier une grande partie de la fonction publique. Comme l'a récemment souligné l'économiste kényan David Ndii lors d'une conférence de presse organisée par la campagne Linda Katiba, lorsque le FMI frappe à la porte, cela signifie essentiellement que le pays est « sous séquestre ». Il ne peut plus prétendre déterminer ses propres politiques économiques. Les pays perdent essentiellement leur souveraineté, un fait qui semble avoir échappé aux technocrates qui se sont précipité·e·s pour obtenir ce prêt particulier.
Lorsqu'il a pris ses fonctions en 2002, le président Mwai Kibaki a tenu la Banque mondiale et le FMI à distance, préférant obtenir de la Chine des prêts sans conditions pour les infrastructures. La politique économique « Regard vers l’Est » de Kibaki a alarmé les institutions de Bretton Woods et les donateurs occidentaux qui avaient jusqu'alors un droit de regard considérable sur la trajectoire de développement du pays, mais elle a insufflé aux Kényan·e·s un sentiment de fierté et d'autonomie qui, malheureusement, a été érodé par Uhuru et ses acolytes ineptes qui sont parti·e·s à la pêche aux prêts, y compris à des euro-obligations massives d'une valeur de 692 milliards de shillings (près de 7 milliards de dollars), ce qui signifie que chaque Kényan·e a aujourd'hui une dette de 137 000 shillings, soit plus de trois fois ce qu'elle était il y a huit ans, lorsque le gouvernement Jubilee est arrivé au pouvoir. À la fin de l'année dernière, la dette du Kenya représentait près de 70 pourcent du PIB, contre 50 pour cent à la fin de 2015. Ce niveau élevé d'endettement peut s'avérer mortel pour un pays comme le Kenya qui emprunte en devises étrangères.
Le gouvernement Jubilee voudrait nous faire croire que le fait que le FMI ait accepté ce prêt est le signe que le pays est économiquement sain, mais comme l'a noté Ndii, c'est bien souvent le contraire qui se produit : le FMI intervient précisément parce qu'un pays traverse une crise financière. Dans le cas du Kenya, cette crise a été précipitée par les emprunts inconsidérés de l'administration Jubilee, qui a vu la dette du pays passer de 630 milliards de shillings kényans (environ 6 milliards de dollars au taux de change actuel) lorsque Kibaki a pris ses fonctions en 2002, à la somme vertigineuse de 7,2 trillions de shillings kenyans (environ 70 milliards de dollars) aujourd'hui, mais sans grand résultat, si ce n'est un chemin de fer à écartement standard (SGR) financé par des prêts chinois qui semble incapable de s'autofinancer. Comme l'a souligné un article d'un quotidien local, cette somme est suffisante pour construire 17 SGR de Mombasa à Nairobi ou 154 super-autoroutes comme celle qui relie Nairobi à Thika. La tragédie est qu'un grand nombre de ces prêts ne sont pas comptabilisés ; en fait, de nombreux·ses Kényan·e·s pensent qu'ils sont utilisés pour remplir les poches de particuliers. Uhuru Kenyatta a lui-même admis que le Kenya perdait 2 milliards de shillings kényans par jour à cause de la corruption au sein du gouvernement. Certains de ces milliards perdus pourraient en fait être des prêts.
Les prêts du FMI, assortis de conditions strictes, ont souvent été présentés comme la solution aux difficultés économiques d'un pays - une mesure de rigueur qui installerait une discipline fiscale dans l'économie d'un pays en augmentant les recettes et en diminuant les dépenses. Cependant, le véritable objectif de ces prêts, selon certain·e·s, est de provoquer des changements politiques majeurs et fondamentaux au niveau national - des changements qui reflètent l'éthique néolibérale de notre époque, avec privatisation, marchés libres et déréglementation.
Le premier signe inquiétant que le gouvernement kényan était sur le point de s'engager sur une voie économique périlleuse a été la visite officielle de la directrice du FMI, Christine Lagarde, au Kenya peu après l'élection du président Uhuru en 2013. À l'époque, je me souviens avoir tweeté que ce n'était pas un bon présage ; cela indiquait que le FMI se préparait à ramener le Kenya dans le giron du FMI.
Le livre de Naomi Klein, La Stratégie du Choc, montre comment ce qu'elle appelle le « capitalisme du désastre » a permis au FMI, en particulier, d'administrer une « thérapie de choc » aux nations victimes de catastrophes naturelles ou d'origine humaine ou de niveaux élevés de dette extérieure. Cela a conduit à la privatisation inutile d'actifs publics, à la déréglementation des gouvernements, à des licenciements massifs de fonctionnaires et à la réduction ou à l'élimination des subventions, autant d'éléments qui peuvent conduire et conduisent effectivement à une augmentation de la pauvreté et des inégalités. Klein est particulièrement critique de ce que l'on appelle l'école d'économie de Chicago qui, selon elle, justifie la cupidité, la corruption, le vol des ressources publiques et l'enrichissement personnel tant qu'ils font avancer la cause des marchés libres et du néolibéralisme. Elle montre comment, dans presque tous les pays où le « traitement » du FMI a été administré, les niveaux d'inégalité ont augmenté et la pauvreté est devenue systémique.
Parfois, le FMI crée une pseudo-crise dans un pays pour le forcer à obtenir un prêt de sauvetage du FMI. Ou, grâce à des données soigneusement manipulées, il donne au pays l'impression d'être en bonne santé économique afin qu'il se sente en sécurité pour demander d'autres prêts. Lorsque le pays ne peut pas rembourser les prêts, ce qui arrive souvent, le FMI lui inflige encore plus de mesures d'austérité (également appelées « conditionnalités »), ce qui entraîne encore plus de pauvreté et d'inégalités.
Les prêts du FMI et de la Banque mondiale pour les projets d'infrastructure profitent également aux entreprises occidentales. Les entreprises privées engagent des expert·e·s pour s'assurer que ces entreprises obtiennent des contrats gouvernementaux pour les grands projets d'infrastructure financés par ces institutions financières internationales. Les entreprises des pays riches comme les États-Unis engagent souvent des personnes qui feront les appels d'offres en leur nom. Dans son « best-seller » international, Les confessions d'un assassin financier, John Perkins explique comment, dans les années 1970, alors qu'il travaillait pour une société de conseil internationale, on lui a dit que son travail consistait à « canaliser l'argent de la Banque mondiale, de l'Agence américaine pour le développement international et d'autres organisations d'aide étrangère vers les coffres d'énormes sociétés et les poches de quelques familles riches qui contrôlent les ressources de la planète ».
Les outils pour atteindre cet objectif, admettait sans honte son employeur, pouvaient inclure « des rapports financiers frauduleux, des élections truquées, des pots-de-vin, l'extorsion, le sexe et le meurtre ». Perkins a montré comment, dans les années 1970, il a joué un rôle déterminant dans la négociation d'accords avec des pays allant du Panama à l'Arabie saoudite, où il a convaincu les dirigeant·e·s d'accepter des projets qui étaient préjudiciables à leur propre population mais qui profitaient énormément aux intérêts des entreprises américaines.
« Au bout du compte, ces dirigeant·e·s sont pris·es dans un réseau de dettes qui garantit leur loyauté. Nous pouvons faire appel à elleux quand nous le souhaitons - pour satisfaire nos besoins politiques, économiques ou militaires. En retour, iels renforcent leur position politique en apportant à leur peuple des parcs industriels, des centrales électriques et des aéroports. Les propriétaires des sociétés américaines d'ingénierie/construction deviennent fabuleusement riches », lui a répondu un collègue lorsqu'il lui a demandé pourquoi son travail était si important.
Les Kényan·e·s, qui souffrent déjà financièrement en raison de la pandémie de COVID-19, qui a vu disparaître près de 2 millions d'emplois dans le secteur formel l'année dernière, vont maintenant être confronté·e·s à des mesures d'austérité au moment précis où iels ont besoin des subventions gouvernementales et des filets de sécurité sociale. La deuxième saison des PAS risque de rendre la vie des Kényan·e·s encore plus misérable à court et moyen terme.
Nous devrons attendre de voir si le mécontentement général à l'égard du gouvernement influencera le résultat des élections de 2022. Cependant, quelque soit le·la vainqueur·e de cette élection, iel devra toujours faire face à la hausse de la dette et aux remboursements insoutenables qui sont devenus l'héritage le plus durable du président Uhuru Kenyatta.
Rasna Warah est une autrice et journaliste kényane. Dans une vie précédente, elle était rédactrice au Programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU-Habitat). Elle a publié deux livres sur la Somalia - War Crimes (« Somalie - Crimes de guerre », 2014) et Mogadishu Then and Now (« Mogadiscio avant-après », 2012) - et est l'autrice de UNsilenced (2016), et Triple Heritage (« Triple héritage », 1998).
Photo: Kelvin Ogome