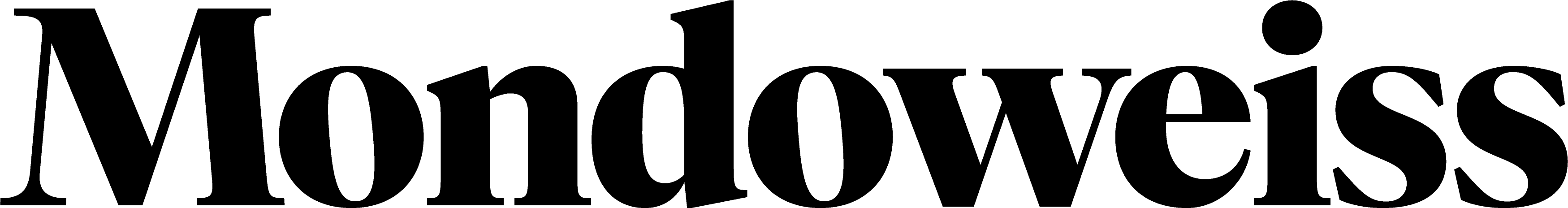Un jour - Sarah se souvient seulement qu'elle était en troisième - ses parents ont invité un parent masculin à dîner. Il l'a regardée et a sévèrement déclaré que sa féminité finirait par déshonorer la maison. "Il a dit que si j'étais comme ça, personne n'enverrait de demande en mariage à aucune des filles de la famille. Je me souviens que mon père s'est tu et qu'aucun d'entre nous n'a terminé son dîner ce soir-là."
Plus tard dans la nuit, le père de Sarah et d'autres membres de sa famille l'ont enfermée dans une pièce et l'ont battue si violemment qu'elle leur a demandé de mettre fin à sa souffrance en lui ôtant la vie. "Avec le recul, je ne blâme personne pour ce qui m'est arrivé", dit-elle. "Mon père ne savait pas quoi faire. Personne dans notre société n'a appris ce qu'il fallait faire avec un enfant qui n'est ni un garçon ni une fille. L'ourdou est une langue tellement riche, mais il n'y a que des mots pour 'fils' et 'fille'. Même la langue ne peut pas me dire ce que je suis pour mes parents."
Sarah ne se rappelle pas combien de jours ont passé, mais elle craignait d'être tuée. Finalement, elle s'est enfuie de chez elle, cachée dans le brouillard de la nuit. Alors qu'elle marchait dans la rue, une voiture s'est arrêtée devant elle et la vitre s'est baissée. "J'étais une enfant de 14 ans qui n'avait nulle part où aller", dit-elle. "Je n'avais pas d'autre choix que de monter dans cette voiture".
Sarah est inhabituellement réticente à parler de ce qui s'est passé ensuite. "Je ne dirais pas qu'on ne m'a pas donné de nourriture ou d'abri - parce que c'est le cas - mais à quelles conditions et en échange de quoi ?". Quelques nuits plus tard, elle a été emmenée dans les rues du centre de Karachi. Sans abri et sans ressources, elle errait sans but depuis des heures lorsqu'elle a été abordée par un groupe de femmes transgenres qui mendiaient à un feu rouge un peu plus loin. Elles l'ont recueillie et se sont arrangées pour qu'elle soit placée chez une gourou - une matriarche de la communauté - qui a accepté de l'élever et de lui donner un abri. Les membres de la communauté lui ont dit qu'il y avait trois façons possibles de gagner sa vie : elle pouvait danser, mendier ou se prostituer. "J'ai décidé de danser lors des fêtes", dit-elle. "Je pense que j'ai dansé dans toutes les villes et tous les villages du Pakistan".
Aussi éprouvante soit-elle, l'expérience de Sarah Gill n'est pas atypique pour une femme transgenre vivant sur le sous-continent indien. Depuis des siècles, les personnes intersexuées - celles qui possèdent à la fois des organes sexuels masculins et féminins - et celles qui ont été assignées homme à la naissance pour ensuite s'identifier comme femme ont quitté leur foyer et rejoint des communautés de troisième genre, où elles ont pu exprimer leur féminité sans crainte de persécution. Ces sociétés sont organisées autour d'un système de parenté guru-chela (maître-disciple) et ont leurs propres règles, rituels et mécanismes de résolution des conflits. Au Pakistan, les termes utilisés pour décrire les personnes qui appartiennent à ces communautés sont variés et parfois utilisés de manière interchangeable. Les plus courants sont les mots hijra et khawaja sira, deux groupes historiquement distincts qui sont confondus aujourd'hui.
Dans l'Inde précoloniale, les khawaja sira étaient des eunuques asservis qui étaient employés dans diverses fonctions bureaucratiques, militaires et de scribes. Selon l'historienne Jessica Hinchy, "ils incarnaient principalement une sorte de masculinité noble et pouvaient aspirer à un statut social assez élevé". Les hijras, en revanche, incarnaient la féminité, travaillant comme des artistes vagabonds qui gagnaient leur vie en bénissant les nourrissons et les jeunes mariés, et parfois en se prostituant.
Bien qu'elle ne soit pas nécessairement aisée, la communauté hijra avait assurément sa place dans la société. Sous le règne des Moghols, par exemple, ils recevaient diverses formes de patronage de l'État, notamment des subventions en espèces, des droits de mendicité et des parcelles de terre fertile. "J'aurais du mal à trouver des exemples dans l'Inde prémoderne où les gens semblaient particulièrement préoccupés par la présence de personnes que nous appellerions aujourd'hui "transgenres"", déclare Audrey Truschke, historienne spécialiste de la période moghole. "Qu'il s'agisse de femmes qui s'habillent en hommes, de personnes intersexuées ou d'eunuques, ils sont là, ils ont leur propre place dans la société, et c'est tout."
La colonisation britannique a toutefois entraîné une vague de persécutions. Les communautés hijra ont été systématiquement visées par la loi sur les tribus criminelles de 1871, les administrateurs coloniaux les considérant comme une présence "impure". "Au milieu du 19e siècle, les Britanniques tentent de connaître et de classer la population indienne de manière plus intense", explique Hinchy. "Les groupes qui sont difficiles à classer et à connaître sont tout simplement anxiogènes pour le gouvernement colonial britannique, et la communauté hijra l'est de multiples façons. Je veux dire évidemment leur incarnation du genre, mais aussi qu'ils sont une communauté basée sur des disciples, donc leurs formes de parenté ne sont pas lisibles pour l'État colonial."
Une autre partie de cette persécution, selon Hinchy, a été la consolidation de concepts binaires de genre en Europe et dans les empires européens aux 18e et 19e siècles. Plusieurs historiens ont affirmé que c'est au 18e siècle que l'on assiste à la solidification d'une conception binaire du genre, qui considère le "mâle" et la "femelle" comme deux catégories incommensurablement différentes et opposées l'une à l'autre", explique-t-elle.
Le plus éminent de ces historiens est sans doute Thomas Laqueur, qui affirme que cette théorie des opposés binaires a été précédée d'un modèle unisexe dans lequel le corps féminin était considéré comme une version ratée ou imparfaite du corps masculin. Bien que problématique en soi, cette façon de penser le genre était nécessairement plus flexible que le modèle binaire qui l'a supplanté. "Il est certain qu'au 19e siècle, cette sorte de conception binaire du genre s'est vraiment consolidée", dit Hinchy. "Et ce n'est pas seulement cela qui est exporté vers les colonies, car la manière dont les conceptions britanniques du genre et de la sexualité ont été façonnées au cours du processus d'accession au rang de puissance impériale fait également partie de cette histoire."
Dans le Pakistan d'aujourd'hui, une grande partie de l'activisme des khawaja sira est centrée sur les effets délétères de cet héritage colonial. Même l'utilisation du terme khawaja sira, qui a été adopté par les législateurs, les activistes et les membres de la communauté comme une catégorie globale pour les personnes de troisième genre vivant au Pakistan, était en quelque sorte nécessaire en raison de la façon dont le mot hijra avait fini par être utilisé comme une insulte.
Le Dr Mehrub Awan, militant de la cause des khawaja sira basé à Karachi, estime que l'injonction de définir son propre genre est le résultat d'un impérialisme culturel. "La question est celle de la modernité et de l'occidentalisme, et de l'hégémonie de la philosophie occidentale de la sexualité", dit-elle. "Cela nous oblige, nous, peuples autochtones de l'Est, à nous positionner dans un cadre de sexualité occidentale afin que nos réalités soient consommables par un public moderne."
Mehrub se souvient qu'elle ne savait pas vraiment ce qu'était le genre avant de commencer à aller à l'école. "Je pense que c'est au jardin d'enfants qu'on m'a dit pour la première fois que j'étais un garçon, dit-elle, et je ne savais pas ce que cela signifiait." Pour la punir de jouer à la poupée et de présenter d'autres formes de comportement "féminin", Mehrub se souvient que ses parents l'enfermaient dans des pièces sombres. "J'ai passé tellement d'années enfermée dans le garage que je me souvenais de chaque centimètre de la moquette en lambeaux. J'avais mémorisé l'emplacement de tous les clous desserrés et des pointes acérées pour savoir où je pouvais et ne pouvais pas m'asseoir."
Bien qu'elle ne se soit jamais sentie à l'aise avec son corps, les pressions sociales étaient telles que Mehrub a passé la majeure partie de sa vie à s'identifier comme un homme. En 2016, elle s'est rendue aux États-Unis dans le cadre d'une bourse Fulbright ; c'est l'expérience de la vie en tant qu'homme gay à Washington, où elle a obtenu un master en santé publique à l'université George Washington, qui l'a convaincue qu'elle ne pouvait plus incarner le masculin. "En gros, j'ai décidé que cette histoire d'être un homme n'était pas pour moi. Je l'avais fait, je n'aimais pas ça et j'y ai dit adieu."
Selon Mehrub, sa prise de conscience a résulté du fait que ses partenaires sexuels attendaient fréquemment d'elle qu'elle se comporte d'une manière hypermasculine. "Je vivais à Pentagon City, qui était rempli de soldats américains. Alors tous ceux avec qui je matchais sur Grindr disaient des choses comme "Je veux que tu me baises comme si j'étais un cheval, et je veux que tu cries Allahu akbar pendant que tu le fais - et je veux que tu fasses de moi ta salope américaine !'", se souvient-elle. "Et puis, dans la culture gaie, il y a beaucoup de masculinité toxique, non ? C'est un peu "On aime les hommes, pas les mauviettes"."
Lorsque Mehrub est retournée au Pakistan deux ans plus tard, le paysage des personnes transgenres et ambigües avait fondamentalement changé. En mai 2018, après des années de militantisme de terrain, le parlement pakistanais a adopté la loi sur les personnes transgenres (protection des droits), un texte législatif historique élaboré pour protéger les droits de "toute personne dont l'identité de genre et/ou l'expression de genre diffère des normes sociales et des attentes culturelles fondées sur le sexe qui lui a été attribué au moment de sa naissance".
La loi, qui est l'une des plus progressistes au monde, définit le terme "identité de genre" comme "le sentiment le plus profond et individuel d'une personne d'être un homme, une femme ou un mélange des deux ou d'aucun des deux" et donne aux individus le droit de s'identifier eux-mêmes. Désormais, le sexe qui vous a été assigné à la naissance n'a plus d'importance ; selon le texte de la loi, une personne peut s'identifier au genre qu'elle souhaite et voir cette identité reflétée dans les documents officiels. La loi interdit également la discrimination à l'encontre des personnes trans dans les écoles, les hôpitaux et les lieux de travail ; elle énonce leurs droits en matière d'héritage et codifie leur droit de voter et de se présenter à des fonctions publiques.
"La loi de 2018 me fait me sentir beaucoup plus en sécurité", déclare Emon Kazmi, une femme transgenre vivant à Islamabad. "Je me sens plus confiante dans mon identité de genre, et je ne m'en excuse pas comme je le faisais auparavant."
Emon a été élevée dans ce qu'elle décrit comme un foyer très conservateur. "Il n'y avait aucune souplesse pour exprimer ma féminité à la maison", dit-elle. "Il était hors de question pour ma famille de l'entretenir".
Son adolescence a été la période la plus difficile de sa vie - si punitive qu'elle avait souvent l'habitude de prier Allah de "réparer ce qui n'allait pas" chez elle. "J'ai dû faire face à beaucoup de harcèlement moral et sexuel en grandissant", dit-elle. "Je n'ai jamais eu d'amis à l'école ou au collège. Mes camarades me sexualisaient ou m'ignoraient..... Cette sexualisation a détruit ma confiance en moi. Je me cachais des gens. Je n'étais à l'aise que seule. Je n'avais pas de vie sociale du tout."
Peu après avoir obtenu son diplôme universitaire, Emon a rencontré des personnes de la communauté trans grâce aux réseaux sociaux. "C'est la première fois que je me suis sentie acceptée", dit-elle. "J'ai compris que c'était ce que j'étais. Je n'ai eu besoin de personne pour me le dire - je l'ai juste ressenti en moi."
Décidant qu'elle ne pourrait jamais revenir à une vie d'homme, Emon s'est installée dans un groupe de femmes transgenres et a entamé le processus officiel de transition vers la féminité. Elle a opté pour ce qu'elle appelle une voie "non chirurgicale", qui consiste à prendre des bloqueurs de testostérone en association avec de la progestérone, et a suivi le traitement sans surveillance médicale. "Il n'y avait pas de loi à l'époque, alors nous avions recours à l'automédication", dit-elle. "Il y a beaucoup de conséquences. Au début, vous devez faire face à de nombreux problèmes de santé mentale. Vos muscles et vos os commencent également à s'affaiblir, ce qui fait que vous vous sentez faible la plupart du temps."
L'expérience du traitement de substitution hormonale peut varier considérablement d'une personne à l'autre. Mehrub décrit le processus comme libérateur - un retour à l'équilibre. Je me suis dit : "C'est tellement naturel, tellement organique. C'est vraiment "Wow, ton corps en avait besoin"." L'adoption de la loi de 2018, fait-elle valoir, a accru la visibilité des personnes transgenres et créé un marché autour des soins de transition : "C'est une économie de niche, mais il y a des médecins qui se spécialisent maintenant dans ce domaine parce qu'ils savent qu'ils auront des clients transgenres."
Cependant, cette même visibilité a également fait de la nouvelle loi l'objet d'une opposition religieuse et de droite. En novembre 2021, le sénateur Mushtaq Ahmed du Jamaat-e-Islami (Parti de l'Islam) a introduit un amendement décrivant la loi originale comme "répugnante" pour l'Islam. L'amendement proposé affirme que la loi, dans sa forme actuelle, portera atteinte à la dignité et à la pudeur des femmes musulmanes, fera de la reconnaissance du genre une question "subjective" et entraînera la légalisation du mariage homosexuel. D'autres politiciens, principalement de la droite religieuse, ont remis en question la clause relative à l'auto-identification et ont demandé la constitution d'un conseil médical pour résoudre les ambiguïtés autour du sexe d'un individu.
Selon Farzana Bari, spécialiste du féminisme et ancienne directrice des études de genre à l'université Quaid-e-Azam, s'il a fallu plusieurs années pour que la loi devienne litigieuse, c'est parce que les législateur·trice·s qui l'ont adoptée ne comprenaient pas pleinement l'expérience des personnes transgenres. "Ils n'ont pas réalisé ce que signifie s'identifier", dit Bari. "Dans leur perception, le mot "transgenre" ne désignait que les personnes dont les organes sexuels n'étaient pas bien définis. Le concept selon lequel votre âme pourrait être piégée dans le mauvais corps ne leur venait pas à l'esprit."
Certain·e·s législateur·trice·s sont allé·e·s au-delà de la proposition d'amendements et font pression pour que la loi soit abrogée dans son intégralité. La loi est contestée devant la Cour fédérale de la Charia, l'organe constitutionnel chargé de veiller à ce que la législation reste compatible avec les enseignements de l'islam. Cette opposition religieuse, selon Mehrub Awan, reflète le désir de l'ultradroite de "régimenter" la moralité en utilisant l'État. "Si vous regardez les droits des trans à travers un prisme hétérosexuel, vous voyez une minorité marginalisée à qui l'État accorde un nombre limité de droits", dit-elle. "Mais si vous le regardez du point de vue de la communauté transgenre elle-même, vous voyez que c'est le seul texte de loi qui peut devenir un exemple de redéfinition du contrat de l'État pakistanais avec son peuple, en reconnaissant sa propre agression, en admettant que cette agression soit de nature coloniale et qu'elle doit être rectifiée."
La loi risquant désormais d'être édulcorée ou abrogée, les militant·e·s craignent un retour à l'époque où les personnes transgenres étaient stigmatisées, incomprises et contraintes à la ségrégation. C'est ce que pense Nayyab Ali, une militante de la cause des khawaja sira qui dirige l'unité de protection des transgenres de la police d'Islamabad. Cette unité a été créée pour encourager les personnes transgenres à signaler leurs griefs directement à la police au lieu de s'en remettre au cadre non officiel de résolution des conflits que constitue le système des gourous et des chela.
"Parce que la société a isolé la communauté khawaja sira pendant si longtemps, la communauté a créé un système distinct avec ses propres règles et sa propre structure de gouvernance", explique Nayyab. Ce système, selon Nayyab, profite aux enfants qui ont été abandonné·es par leurs parents, leur permettant de vivre sous la protection d'un gourou ou d'une mère de famille qui les habille, les nourrit et les héberge. Mais là où il échoue, c'est lorsqu'il s'agit de sortir ces enfants de la marginalité. "Tout comme nous voyons l'enfant d'un médecin devenir médecin et l'enfant d'un ingénieur devenir ingénieur, un gourou transgenre qui a gagné sa vie par le travail sexuel et la mendicité apprendra à ses disciples à faire les mêmes choses."
Nisha Rao est la première avocate transgenre du Pakistan ; elle a passé 15 ans dans le système des gourous-chela et le décrit comme cruel et exploiteur. "Le gourou est censé être à la fois votre mère et votre père", dit-elle. "Pour être une mère ou un père, vous devez accepter les erreurs de votre enfant, les serrer contre votre poitrine malgré leurs échecs - mais dans le système guru-chela, ce n'est pas ce qui se passe. Dans ce système, vous devez payer votre gourou chaque mois à partir de vos revenus. Si tu fais quelque chose de mal, tu reçois une amende. Vous êtes acheté et vendu par différents gourous contre votre volonté."
Dans le système, un chela ne peut quitter son gourou que s'il est acheté par un autre gourou, et le prix de ces transactions peut se chiffrer en millions de roupies. La première fois qu'une personne transgenre est vendue, le prix est déterminé en fonction de l'argent que son gourou a dépensé pour la loger et l'habiller et du nombre d'amendes que le chela a accumulées pour mauvais comportement. Ce qui constitue un mauvais comportement est arbitraire et peut être aussi banal que de ne pas faire couler un bain assez chaud pour le gourou.
Nayyab Ali estime que le prix de la première vente d'un chela se situe entre 100 000 et 150 000 roupies. "Tout gourou qui paie cette somme pour acheter quelqu'un ne le fait pas par gentillesse", dit-elle. "Ils paient 100 000 pour vous afin de pouvoir gagner 200 000 sur votre travail". Comme de nombreuses khawaja sira gagnent leur vie en mendiant, en dansant ou en se prostituant, elles sont effectivement contraintes de doubler leur charge de travail. Cela signifie généralement servir deux fois plus de client·e·s, danser dans deux fois plus de fêtes ou passer beaucoup plus d'heures à mendier dans la rue.
Ce qui rend les choses encore pires, c'est que pour chaque vente ultérieure de la même khawaja sira, les règles de la communauté dictent que le prix auquel elles sont vendues doit automatiquement doubler. "C'est un investissement très sûr", explique Nayyab. "Si vous ne leur rapportez pas assez d'argent, ils vous revendront simplement au double du prix auquel ils vous ont acheté".
Ces transactions sont en fin de compte réglementées par un conseil de familles dirigeantes khawaja sira, à qui l'on doit 25 % de l'argent obtenu de chaque vente. Et comme le pourcentage pour les familles dirigeantes est fixe, elles gagnent plus d'argent à chaque fois qu'un individu est vendu. "C'est pourquoi les gourous traitent si mal leurs chelas", dit Nayyab, qui a été vendue trois fois. "Parfois, ils essaient de provoquer leurs disciples pour qu'ils se comportent mal, afin de pouvoir les vendre à profit".
En vertu de la section 370 du Code pénal pakistanais, acheter ou vendre une personne comme esclave est passible d'une peine de sept ans de prison. Cependant, jusqu'à une date récente, très peu de chelas étaient disposé·e·s à poursuivre leurs gourous, car cela les conduirait quasi certainement à l'excommunication. Selon la structure de gouvernance du système, le gourou se réserve le droit de punir ses disciples en leur coupant leur hukka pani. Tiré d'une expression signifiant "pipe à tabac et eau" en ourdou, ce terme désigne une forme de censure générale qui oblige chaque adhérent du système à ostraciser le contrevenant. Il est interdit aux membres de la communauté de vivre ou de fréquenter cette personne.
Celles qui sont prises en flagrant délit d'interaction avec la personne excommuniée se voient infliger une amende rigoureuse pour avoir enfreint le code, tandis que la contrevenante est empêchée par la force des choses de gagner sa vie en se prostituant ou en mendiant. Si on vous coupe votre hukka pani, explique Nisha Rao, "vous serez expulsée de votre maison, et lorsque vous irez mendier, huit ou dix membres de la communauté viendront vous frapper pour vous empêcher de travailler. Ils déchireront vos vêtements et vous feront errer nue dans les rues".
Comme beaucoup de khawaja sira n'ont pas d'ami·e·s ou de compagne·on·s en dehors du système, cette punition conduit à un isolement total. "C'est vraiment comme si on vous avait mis en prison", explique Zanaya Chaudhry, membre de la communauté et militante basée à Lahore. "Imaginez que vous n'ayez aucun lien avec votre famille ; la société ne vous accepte déjà pas - où allez-vous trouver l'acceptation si ce n'est au sein de la culture khawaja sira ? S'iels vous excluent aussi, où irez-vous ?"
Au cours des dernières années, ces systèmes internes d'oppression ont commencé à faire face à une résistance. Fin 2020, Nayyab Ali a fondé la Free Society - un nouveau groupe au sein de la communauté transgenre dont les membres ne seraient plus acheté·e·s et vendu·e·s et pourraient vivre leur vie sans craindre l'ostracisme et l'exil. Cette révolution, qui a commencé dans le salon de Nayyab, s'est répandue comme une traînée de poudre dans tout le pays. "Nous sommes majoritaires maintenant", dit-elle. "Je peux vous dire que rien qu'à Islamabad, environ 75 % des khawaja sira appartiennent à la Free Society".
Sous la supervision de Nayyab, les membres de la Free Society sont formé·e·s à l'utilisation des réseaux sociaux pour promouvoir leur cause et reçoivent des notions de base sur divers textes de loi. "Notre objectif n'est pas seulement de libérer ces personnes", explique Nayyab. "Nous voulons leur donner les outils dont iels ont besoin pour se défendre. Nous créons des leader·euse·s qui parlent réellement d'indépendance et de liberté."
En représailles, Nayyab raconte que des leaders de la communauté ont décidé de lui couper son hukka pani. J'ai dit : "Et alors ? J'ai fait une vidéo qui est devenue virale en nommant les chefs khawaja sira et en disant que je les excommuniais en retour."
Avec le mouvement qui prend de la vitesse, cependant, l'excommunication est devenue le dernier de ses soucis. "Des gens sont venus chez moi pour me tuer. Des aînés de la communauté ont essayé de m'accuser de blasphème et de manquer de respect au prophète. Je reçois tellement de messages sur WhatsApp disant des choses comme que je vais être brûlée vive ou tuée. Il y a des gens qui rêvent de me tuer toutes les nuits".
Son courage de continuer, dit-elle, est ancré dans sa foi islamique et dans une promesse qu'elle s'est faite à elle-même alors qu'elle se battait pour sa vie. En 2016, alors qu'elle dansait lors d'un festival de musique à Muridwala, Nayyab a été prise en embuscade et aspergée d'acide. Clouée au lit pendant plusieurs mois, elle a décidé que, si elle survivait, elle consacrerait sa vie à se battre pour sa communauté. "Les mouvements nécessitent toujours du sang", dit-elle. "Pour les membres de communautés vulnérables comme la nôtre, avoir peur de la mort, c'est se comporter comme un poulet dans un poulailler. Chaque fois que le boucher sort un poulet pour l'abattre, les autres se mettent à danser parce que leur numéro n'a pas été tiré. Mais in fine, le numéro de chacun sera tiré."
Hasan Ali est journaliste, spécialiste de la politique étrangère des États-Unis et de politique de l'Asie du Sud-Est.