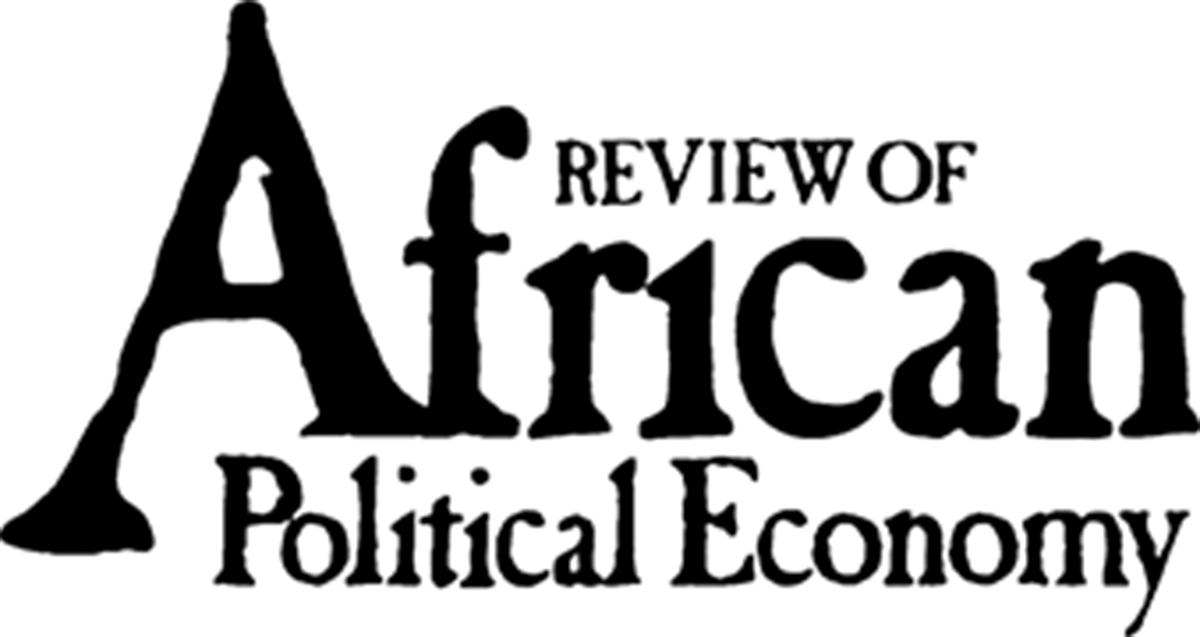Avant d’entamer l’entretien, pouvez-vous nous retracer rapidement votre parcours politique et vos luttes ?
Micheline Ravololonarisoa : issue d’une famille petite-bourgeoise, qui ne voyait pas vraiment les femmes en politique, je n’ai jamais intégré de parti. La politique était perçue comme une affaire d'homme, pleine de dangers et de duplicité. L’essentiel, pour nous autres femmes, était de recevoir une bonne éducation, idéalement en français et sur la France !
C'est là le reflet d’une aliénation totale et d’un esprit colonisé !
Très peu de femmes intégraient les partis politiques, mais dans différents secteurs, des mouvements sociaux étaient en plein essor.
Ainsi, lors de ma dernière année de secondaire avant l’université, après avoir pris connaissance des publications de la Fédération universelle des associations chrétiennes d'étudiants (WSCF, World Student Christian Federation) et entendu parler de leurs actions et de leur pensée, j’ai rejoint le Mouvement chrétien des étudiants de Madagascar (SCM-MPIKRIMA), un mouvement étudiant protestant progressiste et de gauche, membre de la WSCF et du Conseil œcuménique des Églises (World Council of Churches). Il s’agissait d’une communauté mondiale de mouvements étudiants chrétiens, engagée dans le dialogue, l’œcuménisme, la justice sociale et la lutte pour la paix.
C’est au sein de ce mouvement que j’ai découvert la pensée socialiste et que j’ai été « politisée » autour des enjeux de justice sociale, d’égalité, des droits des femmes et de leur participation.
J’ai fait partie d’un groupe qui s’est rendu en Tanzanie pour un stage sur le socialisme, organisé par la WSCF. Par la suite, après mes études universitaires, j’ai quitté Madagascar pour Nairobi (Kenya), où j’ai intégré le bureau africain de la WSCF en tant que responsable de programme, afin de piloter un projet intitulé « Libération ». C'était après une période d’activisme intense au sommet du mouvement étudiant à Madagascar.
Pouvez-vous nous éclairer sur l’histoire politique de l'anti-impérialisme à Madagascar et sur les principaux mouvements politiques qui l’ont traversée ?
Le peuple malgache, comme tous les peuples des anciennes colonies françaises, a résisté au colonialisme et mené des luttes anticoloniales et anti-impérialistes pour s’opposer à l’occupation française et aux politiques coloniales, dans le but de chasser les colons français de leur terre, occupée depuis 1882.
L’enjeu majeur de l’histoire politique de Madagascar a toujours été la lutte pour la libération, d’abord contre le joug colonial, puis contre l’oppression capitaliste.
Ces deux périodes ont été marquées par l’émergence de mouvements populaires structurés.
Dès 1895, alors que Madagascar était encore un protectorat français, et tout au long de la période coloniale jusqu’au début de 1905, le mouvement menalamba (littéralement « ceux aux vêtements rouges » – mena signifiant le rouge et lamba, le pagne porté par les combattants malgaches) fut le principal mouvement anticolonial, organisant et menant la révolte contre l’occupation française sur toute l’île. Leurs actions s’opposaient non seulement aux politiques économiques des colons, en particulier au système fiscal, mais aussi à l'accumulation capitaliste des proches du monarque au pouvoir.
En 1913, le mouvement VVS (Vy, Vato, Sakelika – Fer, Pierre, Ramification) fut créé par un groupe d’intellectuels malgaches, essentiellement des médecins. L’objectif principal de ce mouvement était l’éveil intellectuel et spirituel du peuple malgache « pour une lutte sans relâche afin que Madagascar se libère et recouvre son indépendance ». L’ambition du VVS était de fonder un parti politique dont l’objectif serait de mener la lutte pour la libération totale de Madagascar. Organisé en cellules de dix personnes tout au plus, le mouvement rejetait les politiques coloniales imposées par la France pour asservir Madagascar et appelait à la solidarité pour mener la lutte contre les colonialistes, pour l’égalité des droits et la dignité du peuple malgache. La lutte et les actions du VVS représentaient une menace directe pour les colonisateurs français, qui n’hésitèrent pas à déployer toute la répression possible pour étouffer le mouvement. Bien que plusieurs mouvements de résistance aient émergé dans différentes régions du sud, du nord et de l’est de Madagascar, tous les membres du VVS, accusés de constituer une association illégale, furent arrêtés et emprisonnés. Ils ne furent libérés qu'en 1921, après la fin de la Première Guerre mondiale, à la faveur des pressions exercées par les Églises protestantes et des députés communistes français.
À partir de la dissolution du VVS et en raison des événements politiques mondiaux, notamment la Seconde Guerre mondiale, l’action des mouvements politiques militants a été sévèrement restreinte, le colonisateur refusant aux Malgaches la liberté d'association. Seules les revendications des réformistes, qui aspiraient à ce que tous les Malgaches obtiennent la citoyenneté française et bénéficient des mêmes droits et privilèges que les Français, étaient visibles et « tolérées ».
Les revendications politiques du VVS ont laissé un héritage militant qui a nourri les sentiments nationalistes de nombreux Malgaches progressistes, déterminés à obtenir l’indépendance totale.
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, et avec le retour des Malgaches ayant combattu pour la France, l’interdiction de la liberté d’association fut levée, permettant la naissance de plusieurs associations et partis politiques revendiquant l’autonomie de Madagascar — bien que l’indépendance ne fût pas encore à l’ordre du jour. Parmi les plus en vue, on trouve le groupe d’étude communiste, ainsi que des partis politiques comme le PA.NA.MA (Parti nationaliste malgache), qui affirmaient clairement que l’indépendance ne pourrait être arrachée que par la lutte armée. Leur volonté était de préserver l’unité nationale, de rétablir la souveraineté et de recouvrer l’indépendance par tout moyen. C'était un parti extrêmement bien organisé qui maintenait des liens étroits avec plusieurs autres partis et associations militantes à l’étranger.
Le MDRM (Mouvement démocratique de la rénovation malgache) a été créé en février 1946 à Paris et à Madagascar. Il devint parti politique en juin 1946. Le 29 mars 1947, le MDRM déclencha une insurrection armée contre l’occupation française à travers toutes les régions de Madagascar, d’est en ouest, du nord au sud, y compris à Antananarivo, la capitale. Il préparait, en parallèle, son premier congrès prévu en avril de la même année. Bien que vaincu par l’armée française, et malgré l’arrestation, l’emprisonnement et l’exécution de la majorité de ses dirigeants, l’espoir d’une indépendance pour Madagascar demeura intact.
La France accorda officiellement l’indépendance à Madagascar en 1960.
Pouvez-vous nous parler du soulèvement paysan dans le sud de Madagascar en 1971 ?
Dirigé par le parti politique MONIMA (Mouvement national pour l'indépendance de Madagascar), ce soulèvement était une révolte contre la hausse du prix des denrées alimentaires et manifestait le refus des paysans de se soumettre à l’impôt. Violemment réprimé par le régime, qui les accusa de complicité avec les communistes, le MONIMA fut dissous par le gouvernement. Plusieurs de ses dirigeants furent emprisonnés à Nosy Lava, l’île-prison des prisonniers politiques. Beaucoup y moururent de soif et de faim. Ceux qui survécurent furent libérés en 1971.
Ce mouvement a conduit à la fin du premier gouvernement postcolonial à Madagascar alors que vous étiez un activiste du mouvement étudiant de mai 1972. Pouvez-vous nous parler de ce mouvement et de votre engagement ?
L’origine du mouvement étudiant de mai 1972 et du soulèvement populaire qui renversa le premier gouvernement postcolonial de Madagascar était la situation désastreuse de l’éducation. Le système éducatif de Madagascar était le reflet de la persistance de la domination coloniale française et servait de fondement aux inégalités sociales dans le pays, exacerbées par les divisions ethniques et de classes.
La politique de division dans les programmes et les standards de l’éducation incarnait la stratégie néocoloniale de la France visant à maintenir son emprise sur la formation des élites locales et à en faire des instruments dociles de ses intérêts impérialistes.
De nombreuses forces sociales progressistes, parmi lesquelles des partis socialistes comme le pro-soviétique AKFM (Parti du Congrès de l'indépendance de Madagascar) et le MONIMA, affirmaient que l’indépendance politique accordée par la France en 1960 n’était qu’une première étape dans le long processus de décolonisation. Ce n'était qu'une indépendance de façade. Nous n'étions indépendants que sur le papier.
En mars 1971, onze ans après l’indépendance formelle accordée par la France, les étudiants de la faculté de médecine d’Antananarivo ont entamé une grève pour dénoncer leurs conditions de vie, ainsi que l’inégalité des programmes et des débouchés de leurs études par rapport à ceux de la faculté de médecine de l’université de Madagascar. Cette grève inaugura une période de luttes politiques et économiques intenses, où les tensions idéologiques entre libéraux et socialistes atteignirent leur paroxysme.
Durant cette période de luttes intenses, pouvez-vous nous parler de votre propre engagement ?
En 1972, j’étais en troisième année de langue et littérature malgache à la faculté des lettres et des sciences humaines de Madagascar. Le 24 avril, en soutien aux étudiants en médecine qui exigeaient la révision d’un programme hérité du colonialisme et l’éviction des enseignants français, les étudiants de toutes les facultés de l’université se sont insurgés, donnant naissance à un mouvement national d’une ampleur inédite, qui a rapidement rallié les lycéens. Sous la bannière de la Fédération des associations d'étudiants de Madagascar (FAEM), dont j’étais la secrétaire générale, nous avons mené des campagnes d’information et de sensibilisation visant à apporter une analyse juste et un cadre idéologique clair aux revendications portées par le mouvement. Parallèlement aux actions de sensibilisation, des efforts massifs et organisés ont été déployés à travers tout Madagascar en vue de la formation d’alliances avec des organisations professionnelles et citoyennes.
Pour nous, cette lutte suivait deux axes : d’abord, une décolonisation réelle de Madagascar, permettant au peuple malgache de reprendre en main l’ensemble des moyens de production intellectuels, sociaux, économiques et politiques, grâce à la rupture de l’Accord de coopération de 1960 conclu avec la France, qui incarnait encore la mainmise institutionnelle et idéologique de l’ancienne puissance coloniale. Ensuite, la construction d'un cadre social, économique, politique et populaire, appartenant véritablement aux Malgaches, à leur langue et à leur pensée. C'est le principe de la « malgachisation » tel qu'exprimé plus tard dans la Charte de la révolution socialiste malgache (1975) rédigée par l'amiral « rouge » Didier Ratsiraka (1936-2021) [[1]](https://roape.net/2024/10/23/the-struggle-in-madagascar-an-interview-with-micheline-ravololonarisoa/#_ftn1).
Ainsi, les assemblées organisées durant la grève étaient des moments d’intense activité politique, d’éducation populaire et de sensibilisation, où les étudiants des universités et des collèges universitaires pouvaient analyser, débattre, proposer et élaborer des stratégies pour l'avenir du mouvement.
Bien que certains leaders du mouvement appartinssent à des partis politiques, celui-ci restait autonome par rapport à toute formation politique. Son objectif principal était d’analyser et de comprendre les causes profondes des inégalités, non seulement dans le système éducatif, mais aussi dans la société malgache dans son ensemble, et de chercher l’alternative qui pourrait mettre fin à cet ordre injuste, discriminant et inégalitaire.
Nous avons organisé la grève et instauré les structures nécessaires à l’analyse, à la réflexion collective et à la mise en place d’une stratégie de réforme sociale et politique portée par le plus grand nombre.
En tant que l’une des deux représentantes des étudiants de la faculté des lettres et des sciences humaines, et en tant que secrétaire de la FAEM, je me suis retrouvée en première ligne pour définir les objectifs du mouvement et garantir une large participation. Malgré la répression brutale du régime en place, et animés par la « détermination inébranlable pour nous débarrasser » de ce que Lénine qualifiait d’« amateurisme dans la lutte », nous avons commencé à bâtir minutieusement « une organisation de révolutionnaires capable d’apporter force, stabilité et continuité à la lutte politique », dans le but de forger un avenir socialiste pour Madagascar.
Nous nous sommes nourris des expériences d’étudiants et des luttes populaires engagées à l'étranger, notamment en Amérique latine, que nous analysions et discutions lors de nos assemblées.
Des tracts furent rédigés par la Commission d’étude et diffusés dans tout le pays. Cette action a été soutenue par la solidarité des compagnies de transport qui les acheminaient gratuitement vers les différentes provinces. Enfin, nous autres membres du comité de direction, prenions en charge l'organisation des débats quotidiens dans les écoles et lors des assemblées générales. C’étaient bien souvent les représentants étudiants qui guidaient le mouvement.
Pouvez-vous nous parler des événements et des résultats concrets de ce mouvement ?
L’un des acquis majeurs du mouvement fut la possibilité pour les étudiants de s’exprimer librement, d’adopter des formes d’expression inédites et un vocabulaire novateur, en rupture avec la culture malgache traditionnelle, sans subir la censure parentale. Une véritable émancipation, peut-être même une libération totale.
Dans la nuit du 12 mai 1972, alors que nous nous réunissions comme à notre habitude dans le grand amphithéâtre de l’université pour faire le bilan des discussions des séminaires et débattre des moyens de forger des alliances avec différents groupes sociaux — syndicats de travailleurs, enseignants, professions libérales, parents, jeunes sans emploi, organisations paysannes — et d’élaborer une position commune face à la proposition du gouvernement de reprendre les cours et d’engager des négociations, nous avons été confrontés à une répression brutale.
Le comité de grève, dont je faisais partie, se retrouvait au bureau de la FAEM pour organiser la manifestation prévue pour le lendemain matin, tandis que la réunion régulière du comité permanent de grève, composé de deux délégués par établissement, se déroulait dans le grand amphithéâtre de l’université. Tous les participants dans la salle furent encerclés par les FRS (Forces républicaines de sécurité). Les mineurs de moins de 18 ans furent écartés, tandis que les autres furent arrêtés et envoyés à Nosy Lava, l’infâme île-prison. J’ai été incarcérée comme tous ceux qui avaient été arrêtés.
C’est en réponse à ces arrestations que des soulèvements éclatèrent dans toute la capitale d'Antananarivo, tandis que les Forces républicaines de sécurité (FRS) réprimaient violemment les manifestants à coup de balles réelles. C’est au cours de ce soulèvement que le ZOAM (Jeunes chômeurs malgaches) — un groupe majoritairement composé de jeunes des quartiers pauvres “noirs” de la capitale — s’affirma comme une force incontournable en assurant la protection des manifestants désarmés face à la répression violente. Face à la protestation populaire, le régime chercha à reprendre le contrôle en instaurant une junte militaire capable de prendre les rênes du pouvoir. Cette proposition a provoqué une fracture profonde : d’un côté, certains l’ont soutenue, tandis que d'autres, comme le mouvement étudiant, l'ont fermement rejetée.
La montée en puissance du ZOAM et sa reconnaissance comme une force politique à part entière, incarnant les revendications du sous-prolétariat urbain et des chômeurs, et capable de proposer ses propres solutions tout en accédant à une place dans les instances du mouvement, marque un tournant décisif dans le soulèvement populaire qui a bouleversé le paysage politique malgache.
Une organisation structurée et une montée en conscience politique au sein des différentes forces sociales ont jeté les bases d’un cadre théorique et politique précis pour une « seconde indépendance ». Pourtant, ces avancées ont été entravées par l’élection, via référendum, d’une junte militaire de transition (1972-1975), marquant la fin du régime du Président Tsiranana.
Cependant, les discussions sur le cadre et les stratégies de mise en œuvre se sont poursuivies lors du « Zaikabe », le Congrès populaire, tenu au début de septembre 1972.
En amont de ce congrès, s'est tenu un Séminaire national visant à préparer les débats, en prenant en compte les propositions des différents acteurs.
Lors du congrès, des propositions sur les systèmes sociaux, économiques et politiques à instaurer furent avancées, tandis que les organisations paysannes, représentant environ 15 % des participants, exigeaient la restitution des terres spoliées par les grandes entreprises capitalistes françaises.
Après le mouvement de 1972 et la tenue du Congrès national, la mise en œuvre de la résolution fut confiée au gouvernement militaire. Comme l’objectif du mouvement étudiant et populaire n’était pas de prendre le pouvoir, mais de proposer un modèle de gouvernance, la junte militaire, ayant pressenti cette faiblesse, adopta la même politique que le régime déchu.
Suite au mouvement à Madagascar, pouvez-vous nous dire ce que vous avez fait par la suite ?
Après le démantèlement du mouvement et la décision de la junte militaire d’organiser un référendum sur l’avenir politique de Madagascar, il m’est apparu que nous avions franchi un seuil irréversible. J’ai alors pris la décision de quitter le pays.
Reconnaissant mon rôle dans le mouvement étudiant à Madagascar, la WSCF (Fédération universelle des associations chrétiennes d'étudiants) m’a assigné la direction du programme Libération. Ce programme avait pour objectif d’informer, de sensibiliser et de mobiliser les étudiants des universités africaines afin de manifester leur solidarité avec les peuples des anciennes colonies portugaises, du Zimbabwe et d’Afrique du Sud, toujours opprimés sous le régime de l’apartheid. La WSCF cherchait à informer, sensibiliser et mobiliser les étudiants africains contre l’apartheid.
Forte de mon expérience à Madagascar, où j’ai compris que l’information est cruciale pour la compréhension des dynamiques politiques et la recherche de solutions, j’ai créé un bulletin d’information intitulé Libération. Ce bulletin se focalisait sur chaque pays et proposait des questions à débattre avec les étudiants lors de mes interventions dans les universités que je parcourais. Je me suis également impliquée auprès des représentants des mouvements de libération à travers l’Afrique, notamment ceux implantés en Tanzanie et en Zambie.
J’ai eu l’occasion de rejoindre des groupes d’étude sur le socialisme, les luttes de classes et les luttes anti-impérialistes, organisés par divers mouvements sociaux africains. Ces discussions m’ont permis de dialoguer avec des penseurs socialistes aujourd’hui reconnus, notamment de l’Afrique de l’Est, tels que le défunt Babu, Issa Shivji, Mahmood Mamdani et Yash Tandon, entre autres. Chacun de ces échanges a enrichi ma réflexion et consolidé ma détermination à œuvrer pour le changement, la libération, l’égalité et la justice en tant que femme africaine.
Enfin, pouvez-vous nous parler de vos lectures et des conclusions que vous avez tirées, au fil du temps, de votre engagement militant à Madagascar ?
Installée à Nairobi, j’avais à ma disposition des ouvrages en anglais, ce qui m’a permis de plonger avec avidité dans les classiques de la lutte des peuples africains, d’autant plus qu’à Madagascar, l'accès aux livres sur l’Afrique était limité.
Le livre qui m’a le plus éclairée, et qui continue de nourrir ma réflexion, est Comment l'Europe sous-développa l'Afrique (1972) de Walter Rodney. À tel point qu’avec d’autres organisations progressistes de Nairobi et le Conseil national des Églises du Kenya, nous avons invité Walter Rodney pour s’adresser aux étudiants de l’université de Nairobi et aux membres de divers mouvements sociaux. Cela nous a permis d’approfondir notre analyse de l’exploitation capitaliste et de réfléchir aux moyens de nous organiser pour participer activement à son renversement.
Plus tard, en tant que commissaire du Programme de lutte contre le racisme du Conseil œcuménique des Églises, la compréhension des thèses de Rodney m’a permis de m’engager pleinement dans le mouvement réclamant le retrait des investissements d'Afrique du Sud et de mobiliser les étudiants en solidarité avec les Aborigènes d’Australie et les Tamouls du Sri Lanka.
En 1975, c’est la vie familiale qui m’a amenée en Europe, d’abord à Genève. Je suis revenue à Nairobi en 1978, où j’ai retrouvé des camarades du mouvement social qui, à ce moment-là, s’étaient réfugiés dans la clandestinité. Ils publiaient le bulletin PAMBANA, interdit par le gouvernement de Moi, et plusieurs d’entre eux étaient détenus à cause de cela. Mon engagement politique consistait à apporter ma solidarité aux familles de ces camarades, autant que possible, dans un contexte de répression. Nous avons quitté le Kenya pour le Canada lorsque mon mari est sorti de prison après avoir été incarcéré sur le fondement d'un dossier monté de toutes pièces.
Au Canada, je me suis inscrite à un programme de troisième cycle en études féministes à l’université de Waterloo, tout en enseignant le français dans cette même université et à l’université Wilfrid Laurier, jusqu’en 1991, lorsque nous avons quitté le Canada pour le Royaume-Uni, où mon mari a obtenu un emploi.
J’ai d’abord rejoint l’Africa Centre, avant de fonder l’Agence pour la coopération et la recherche pour le développement. En tant que responsable du portefeuille de l’Afrique de l’Ouest, couvrant le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad et la Mauritanie, j’ai également lancé de nouveaux programmes en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone.
En termes de leçons tirées de mon engagement politique en tant que femme africaine, je dirais que les débats, les discussions et les enseignements lors des séminaires étudiants de 1972 ont permis de développer des connaissances qui ont profondément marqué et orienté mon parcours par la suite. Le mouvement étudiant a provoqué une mutation radicale des consciences, mettant en lumière ce qui n’allait pas, ce qui devait être transformé, comment ce changement pouvait se réaliser, et quel rôle je pouvais y jouer.
Les débats ont également mis en lumière la notion d'indépendance réelle, opposée avec celle d’indépendance formelle.
Notre ambition en tant qu’étudiants n’était pas de prendre le pouvoir, mais de favoriser l’émergence d’un État démocratique capable de répondre aux besoins des citoyens malgaches et d’accompagner la réalisation de leurs aspirations.
Les pratiques politiques actuelles ne semblent pas permettre l’émergence d’un tel processus, d’où le retour à cette question fondamentale. Que faut-il donc faire ?
Micheline Ravololonarisoa a été militante socialiste toute sa vie. Elle a travaillé pendant de nombreuses années en tant qu’écrivaine et consultante en développement. Elle vit à Londres avec son mari.
Foto: ROAPE via Micheline Ravololonarisoa. La photographie principale montre Micheline en train de prendre la parole après que le gouvernement ait rejeté les revendications des étudiants lors des soulèvements populaires de 1972.
Notes :
[1] La malgachisation ne se limite pas à l’adoption de la langue malgache, mais incarne également un principe visant à réorganiser les programmes et les méthodes éducatives en fonction des « impératifs révolutionnaires » d’une idéologie socialiste, dans l’objectif de « bâtir un État socialiste véritablement malgache, fondé sur la philosophie, les valeurs, la manière de pensée et la langue malgaches » (Charte de la révolution socialiste malgache).