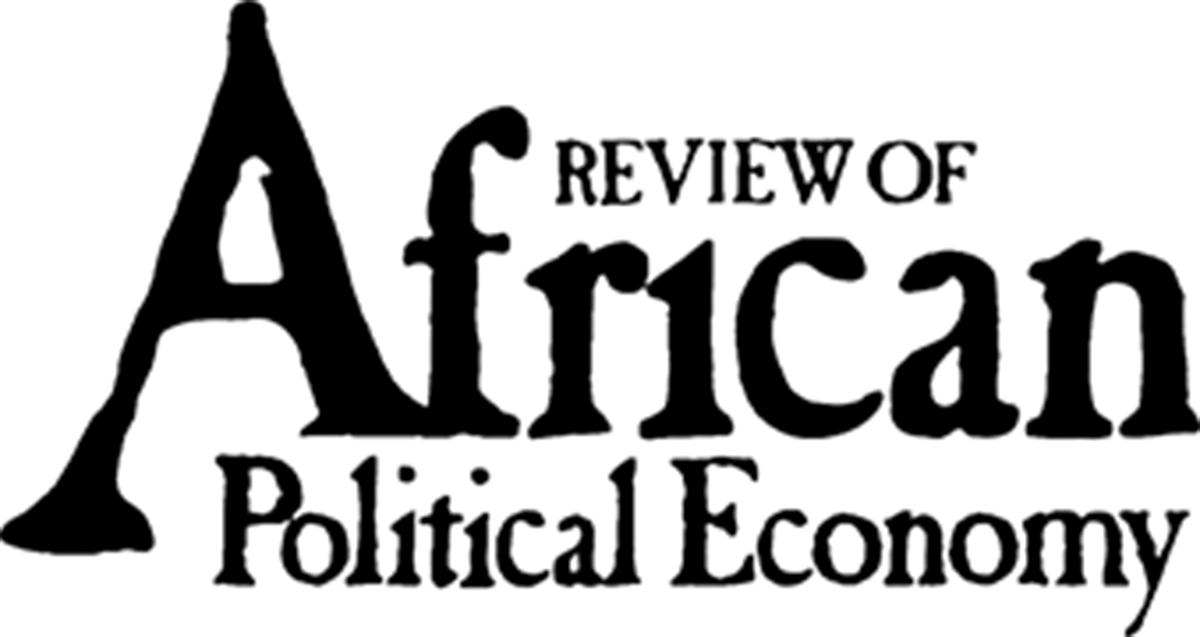L’investisseur est parti / avec notre terre hier, / et pourtant, nous arrachons notre destinée / des mains d’un sort qui se rétrécit.” – Harriet Anena, « Arracher la destinée »
Un jour en 1954, ou peut-être l’année suivante, de jeunes travailleurs du Département de la chasse et de la pêche en Ouganda ont introduit clandestinement des perches du Nil d’une jetée à Entebbe, transformant à jamais le lac Victoria. Jusque-là, ses eaux étaient parsemées d'enkejje colorés, des variétés de cichlidés haplochrominés, qui gardent leurs petits en bouche le temps qu'ils grandissent. « L’Haplochromis est généralement considéré comme un " poisson déchet " de très peu de valeur », écrivait Alec Anderson, l’officier britannique des pêches qui a orchestré l’introduction de la perche du Nil. « Il semble évident que la meilleure façon d’utiliser les Haplochromis est d’introduire un prédateur qui les convertira en quelque chose ayant plus de valeur. »
En quelques années à peine, les pêcheurs tanzaniens attrapaient des perches du Nil sur une rive lointaine. Dans les années 1980, le lac avait atteint un point de basculement, son équilibre étant perturbé par la prolifération d’algues, la baisse des niveaux d’oxygène et l’appétit vorace du nouvel intrus. Plus de la moitié des espèces d'haplochrominés ont disparu. Des biologistes néerlandais ont écrit que leur disparition « pourrait bien représenter le plus grand événement d’extinction parmi les vertébrés au cours de ce siècle ». Entre-temps, la valeur économique de la pêche a quintuplé parce que la perche du Nil, plus charnue, pouvait être vendue à des acheteurs internationaux. Un désastre écologique est devenu un triomphe commercial.
Les pêcheurs qualifiaient la perche du Nil d'« or du lac », même si bien peu de la prise arrivait à leurs tables. Des commerçants européens et asiatiques ont ouvert des usines de transformation du poisson sur le littoral, où les filets étaient emballés dans du polystyrène et de la glace, avant d'être transportés par avion aux quatre coins du monde. Au milieu des années quatre-vingt-dix, le poisson était devenu le deuxième produit d’exportation de l’Ouganda. Les propriétaires d’usines affirment aujourd’hui que le secteur fait vivre plus d’un million de personnes au total.
La commercialisation du lac a cependant également nécessité de nouvelles tactiques pour le surveiller, car la perche du Nil, une espèce lucrative, était elle-même menacée par la surpêche. Après des expériences timides de gestion communautaire, le gouvernement a opté pour des patrouilles militaires. Des soldats ont arrêté et frappé les barias qui manœuvraient les bateaux. Les pauvres ne pouvaient pas se sortir d'affaire en versant des pots-de-vin, ni s’offrir les grands bateaux qui étaient désormais requis par la loi. « Quand les programmes gouvernementaux arrivent, ils viennent avec ceux qui sont éduqués, riches, qui font partie de l'élite », m’a un jour dit un pêcheur vétéran, « et le gouvernement envoie ses soldats à la chasse aux pauvres. » Aux débarcadères le long du rivage, les pêcheurs murmurent et se rappellent ce qu’ils ont perdu : leurs maisons démolies, leurs bateaux incendiés, leurs amis qui se sont noyés en tentant de s’échapper.
La parabole du lac est l’histoire de tout l’Ouganda : de sa terre, de ses arbres, de ses roches, de son bétail, de ses cultures, de sa main-d’œuvre, de sa politique. En tenant compte de l’inflation, l’économie a augmenté de près de huit fois sa taille depuis que Yoweri Museveni s'est emparé du pouvoir en 1986. Mais cette prospérité n'est pas vécue par tout le monde. Le même processus de marchandisation qui a apporté du profit à certains est ressenti par d’autres comme une source d’incertitude et de menace, souvent entrelacée de violence. La situation difficile de l’Ouganda ne peut pas être comprise en termes politiques limités (tels que "démocratie", "militarisme", "droits") sans également aborder ces déchirements sociaux. C’est ainsi que le marché, à l’instar de la perche du Nil, s’attaque aux choses qu’il considère comme « ne possédant que très peu de valeur » et « les convertit en quelque chose de valable ».
Gros poissons et gros lot dans la mare
Les plaines arides de Karamoja, dans le nord-est de l’Ouganda, sont aussi éloignées que possible des eaux tumultueuses du lac Victoria. Vu de Kampala, il s’agit d’une périphérie permanente, dont le retard est mis en évidence par des cycles mortels de vols de bétail. « Nous n’attendrons pas que le Karamoja se développe », a déclaré Milton Obote, le premier Premier ministre du pays après l’indépendance. Cela peut sembler un endroit improbable pour rechercher une transformation commerciale.
Mais il est erroné de considérer les vols de bétail comme un vestige du passé. En 1979, des soldats ont abandonné l’armurerie de Moroto après la chute d’Idi Amin. Pendant des jours, les Karamojong ont vidé ses réserves, chargeant des fusils sur le dos des ânes comme s'il s'agissait de fagots de bois. Ce fut un moment déclencheur, comme un poisson jeté dans un lac. La prolifération des armes légères a permis à la pratique ancestrale des raids de gagner en létalité et en ampleur.
Autrefois, les jeunes hommes menaient des raids pour reconstituer des troupeaux, accumuler une dot, ou montrer leur audace. Ces motivations étaient désormais renforcées par l'appât du gain Les économies d’échelle ont permis aux gangs de transformer les raids en une entreprise à part entière en vendant du bétail dans des réseaux commerciaux qui alimentaient la demande de viande dans des villes lointaines ou qui grossissaient les troupeaux des élites fortunées. Lors de la plus récente recrudescence de violence, qui a commencé en 2019, l'ensemble de la population, du président aux citoyens les plus modestes, a dénoncé la « commercialisation » des raids. Les éleveurs suivaient les traces des troupeaux volés jusqu’à ce que la piste disparaisse sur les routes goudronnées, où les vaches avaient été chargées dans des camions et emmenées. D’une manière ou d’une autre, les véhicules ont réussi à passer les points de contrôle officiels. Les dirigeants locaux se demandaient, avec insistance, pourquoi ils trouvaient des cartouches de balles de l’armée après les raids.
Karamoja est vidé de son bétail, tout comme le lac Victoria est vidé de ses poissons. Une enquête menée en 2017 par l’Unité de soutien à la résilience de Karamoja, un groupe de recherche, a révélé que 57 % des ménages n’avaient pas assez d’animaux pour vivre principalement de leur bétail. Au lieu de cela, ils survivent grâce à d'autres activités : ils brassent de la bière, creusent pour gagner leur vie, abattent des arbres pour en faire du charbon de bois, extraient du calcaire, tamisent la terre à la recherche d'or, ou fuient par les mêmes routes que celles où le bétail a disparu.
Lorsque l’armée balaie les villes à l’aube, rassemblant les jeunes hommes à la recherche d’armes illégales, elle libère d’abord ceux qui parlent bien anglais, puis seulement les chauffeurs de boda-boda, et en dernier les hommes qui transportent des jerrycans de kwete fait maison à l’arrière de leur vélo. « Ils catégorisent maintenant les gens en fonction de leur apparence », a déclaré un détenu, me parlant deux jours après une rafle en 2022. La structure de classe émergente fait également office de hiérarchie de la suspicion.
Quitter la terre
Le lac et les plaines sont, chacun à leur manière, des lieux en marge. Cependant, on retrouve également ce même processus de marchandisation dans le cœur agricole du pays, dans la lutte pour la terre. Depuis l’indépendance en 1962, la superficie des terres cultivées en Ouganda n'a que légèrement doublé, alors que la population rurale a augmenté de près de six fois. Les deux tiers des ménages agricoles possèdent aujourd’hui moins d’un hectare, soit la taille d’un grand terrain de football ; environ 40 % d’entre eux en possèdent moins de la moitié. La croissance des villes a également fait grimper le prix des terrains à leur périphérie.
Les tensions sont particulièrement visibles dans la région du Buganda, où se trouve la capitale, Kampala. Une grande partie des terres ici relève d’un système de régime foncier inhabituel : le mailo, où les droits des propriétaires et des occupants se chevauchent. Selon la loi, toute personne ayant des droits de kibanja sur une parcelle de terrain ne peut pas être expulsée tant qu’elle paie un loyer foncier symbolique, fixé à quelques dollars par an. Mais les propriétaires tentent de contourner cette restriction afin de pouvoir profiter de la hausse des prix des terrains. L’une des stratégies consiste à vendre le titre à de nouveaux propriétaires ayant des liens politiques, qui usent de leur influence pour expulser les détenteurs de kibanja au mépris de la loi. La justification implicite est que la terre devrait revenir à ceux qui peuvent en tirer le meilleur profit, ce qui est supposé désigner les exploitations agricoles commerciales, les entreprises industrielles et les projets résidentiels. « Si vous avez quelque chose de valeur que vous ne voulez pas vendre, [les accapareurs de terres] utiliseront d’autres moyens », a déploré Matia Lwanga Bwanika, le président du district de Wakiso, lorsque je l’ai rencontré en 2023.
Des pressions similaires se font sentir dans tout le pays, même si les marchés fonciers restent généralement minces. Dans la région d’Acholi, au nord, de nombreux agriculteurs sont revenus des camps de déplacés après la guerre avec les rebelles de Joseph Kony pour découvrir que leurs champs étaient destinés à des plantations de canne à sucre ou à des réserves de chasse. À Bunyoro, les querelles foncières ont explosé en prévision de l’exploitation pétrolière. Comme l’a fait remarquer le chercheur Yusuf Serunkuma, le paiement d’indemnités en espèces dans les cas d’acquisition de terres remodèle les économies locales, les moyens de subsistance, les relations entre les sexes et bien d’autres choses encore. « Aujourd’hui, ils ont vu que l’argent est arrivé, ils ont changé les choses », chante l’artiste alur Professor Lengmbe dans sa chanson « Refinery » (Raffinerie), expliquant que les hommes veulent désormais « une [femme] à la peau claire » parce que « celle à la maison est trop noire ».
Bombe à retardement
Dans chacun de ces exemples, on perçoit une note de pessimisme malthusien : le sentiment qu’il n’y a plus assez de poissons, de bétail ou de terres pour tout le monde. Mais il s'agit de bien plus qu'une simple crise de croissance démographique. L'économie monétaire exerce une pression sur la vie quotidienne de toutes parts, une emprise qui se fait également sentir dans l’expansion du travail salarié occasionnel, les commerces illicites de bois et de charbon, les pratiques féroces du commerce du café, l'envolée des coûts des campagnes politiques, la difficulté à payer les frais de scolarité ou l’inlassable agitation de la vie urbaine. Les chaînes commerciales s’étendent à l’échelle régionale, comme dans le commerce du bétail, ou à l’international, comme dans l’exportation de poisson, d’or et de travailleurs domestiques. Le profit revient à ceux qui disposent de la plus grande influence politique, de la plus grande puissance juridique, du plus grand pouvoir de marché ou du meilleur accès au crédit – ou, tout simplement, à ceux qui ont le moins de scrupules.
Il ne s'agit pas ici de regretter une version idéalisée du passé, qui n'a jamais existé, ni d'idéaliser la subsistance à petite échelle, qui n'est en rien une voie vers la prospérité pour un pays. Certains Ougandais trouvent des opportunités en tant qu'« entrepreneurs » ou « consommateurs ». Même les critiques les plus sévères du capitalisme reconnaissent son immense pouvoir de mobiliser des ressources, de permettre la spécialisation et d’étendre la production. Mais la « perturbation ininterrompue de toutes les conditions sociales », comme l’appelait Marx, est particulièrement turbulente dans une société comme l’Ouganda contemporain, à l’extrémité de l’ordre mondial, qui depuis les années 1980 a été un terrain d’essai pour les réformes menées par le marché.
L’économiste politique hongrois Karl Polanyi, écrivant dans les années 1940, a décrit un « double mouvement » dans l’histoire du capitalisme : d’abord une volonté de détacher le marché de ses attaches sociales, puis un contre-mouvement visant à le contenir. Dans l’Ouganda d’aujourd’hui, où les syndicats, les coopératives et les partis politiques ont été mis à mal, il est difficile de discerner une résistance organisée. Dans son tube de 2014 « Time Bomb » (Bombe à retardement), le chanteur Bobi Wine a déploré le prix élevé de l’éducation et de l’électricité, mais en tant que leader de l’opposition, il a montré peu d’intérêt pour l’économie. Alors que les usines et les mines des pays industrialisés ont historiquement constitué un vivier de solidarité, l’économie informelle de l’Ouganda est fragmentée et ses travailleurs sont atomisés. Ils sont trop occupés à chercher « ka money », un peu d'argent en plus, au sein du système existant pour en inventer un nouveau.
Mais cela ne signifie pas que les Ougandais sont à l’aise avec le nouvel ordre. Le mécontentement est omniprésent, qu'il s'agisse des manifestations contre l'accaparement des terres, des incendies de plantations de canne à sucre ou des plaintes des intellectuels dissidents. Et il vit dans les chuchotements des conversations quotidiennes. « C’est à cause des voleurs », m’a dit une femme de Wakiso alors que des voyous armés de bâtons regardaient son jardin de bananes. « Ce sont eux qui mettent le pays sens dessus dessous. » Les hommes avaient été envoyés par un arpenteur qui voulait mettre en valeur la terre, la vendre, en tirer profit, bref, la transformer en quelque chose de valeur.
Liam Taylor est journaliste indépendant. Il a été basé en Ouganda de 2016 à 2022.
Photo à la Une : Pêcheur sur le lac Victoria en janvier 2023 (Wiki Commons)