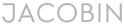Après sa victoire écrasante aux élections présidentielles mexicaines, la coalition MORENA ne perd pas de temps pour se mettre au travail. Avant même que la présidente élue Claudia Sheinbaum ne prenne ses fonctions le 1er octobre, le nouveau congrès examine un ensemble de révisions constitutionnelles proposées par le président sortant Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO), en s’appuyant sur une majorité qualifiée de deux tiers qui permet au parti présidentiel de passer de telles mesures pratiquement tout seul. Or, la première révision proposée s’attire déjà les foudres des grands médias et des puissances étrangères : il s’agit d’une réforme exigeant des élections populaires directes pour l’ensemble de l’appareil judiciaire fédéral.
Le 22 aout, l’ambassadeur américain à Mexico, Ken Salazar, a publié un communiqué opposant les réformes. Ce communiqué était, pour ainsi dire, intéressant. Après avoir cité l’Irak et l’Afghanistan, deux pays récemment envahis et occupés par les États-Unis, comme exemples de pays dépourvus de systèmes judiciaires indépendants, il a affirmé que « l’élection populaire directe des juges présente un risque majeur au fonctionnement de la démocratie mexicaine ». Suite à cette affirmation, s’ensuivit la menace : « Je pense aussi que ce débat… mettra en péril les relations commerciales historiques que nous avons construites et qui reposent sur la confiance des investisseurs envers le système juridique mexicain ». En d’autres mots, si vous savez ce qui est bon pour vous, laissez tomber.
AMLO, semblait-il, ne savait pas ce qui était « bon pour lui ». « Comment pouvons-nous permettre à l’ambassadeur américain, avec tout le respect que je lui dois… d’estimer que nos actions sont mauvaises ? » a-t-il demandé lors de sa conférence de presse le mardi suivant. Tout en réfutant l’expulsion l’ambassadeur, il a expliqué que les relations avec l’ambassade étaient « en pause ». Il a ajouté qu’il en allait de même pour l’ambassade canadienne, dont l’attitude, au soutien des États-Unis, avait été « pitoyable… comme un état vassal ». Il a conclu en déclarant : « les deux pays voudraient interférer dans des affaires qui concernent seulement le peuple mexicain. Tant que je serais là, je ne permettrai aucune violation de notre souveraineté. » La ligne de front a clairement été tracée.
La volte-face de Ken Salazar
La lettre de l’ambassadeur, ainsi que la conférence de presse qui l’a suivi, étaient d’autant plus surprenantes en considérant qu’il avait tenu des propos exactement contraires deux mois plus tôt. La réforme judiciaire « est une décision mexicaine », avait-il déclaré le 13 juin. « Ce n’est pas notre décision. Nous, les États-Unis, ne pouvons pas imposer nos opinions dans ces affaires. » Le 24 juillet, il a réaffirmé : « le modèle [de la réforme] constituera la décision du gouvernement mexicain, de la législature mexicaine. Je ne vais pas m’impliquer dans ces décisions. » A peine quelques jours avant sa volte-face, il déclarait encore que la réforme judiciaire représentait « une opportunité d’accomplir de bonnes choses », et que les États-Unis n’étaient « pas en position » de dicter au Mexique ce qu’il devait faire.
Suite à cette déclaration brutale, Salazar a continué à se perdre en conjectures rhétoriques. Confronté au retour de bâton non seulement du président mais aussi d’un public historiquement critique de l’intervention américaine, il a d’abord essayé de faire marche-arrière, prétendant que ses commentaires avaient été faits dans un « esprit de collaboration », en tant que « partenaires », et qu’il avait la plus grande intention de dialoguer sur la question. Cependant, cette prétendue décontraction est totalement passée à côté de l’essentiel : la réforme judiciaire n’était pas une question pour laquelle un « dialogue » avec les Etats-Unis était souhaité ou approprié. Salazar s’est donc replié dans l’attaque, martelant son point sur l’Irak et l’Afghanistan dans un interview pour Milenio TV tout en affirmant que la réforme violait « l’esprit de l’ACEUM (Accord Canada–États-Unis–Mexique ) », qui remplace l’ ALENA (Accord de libre-échange nord-américain), sachant pertinemment que ce n’était pas le cas. Le 3 septembre, il en était à argumenter que, oui, les États-Unis élisent aussi leurs juges, mais seulement au niveau des états (où la plupart des dossiers sont jugés) et seulement dans quelques états (41 d’entre eux, en totalité ou en partie, en réalité), et que, quelle que soit l’opinion de la presse présente, elle était toujours la bienvenue à l’ambassade.
L’appel de Washington
Une volte-face aussi brusque n’a manifestement pas été orchestrée à Mexico City, mais à Washington. La question, bien sûr, est par qui. Dans l’absence de pouvoir émanant de la Maison-Blanche de Joe Biden, d’autres centres de pouvoir à l’intérieur du gouvernement fédéral se sont empressés de combler le vide, s’empiétant les uns les autres au passage.
En conséquence, les politiques concernant l’Amérique latine ont été en sens dessus dessous ces derniers moins. Quand l’Equateur a envahi l’ambassade du Mexique en avril, une violation flagrante du droit international, la réponse tiède du département d’État a par la suite été « corrigée » par le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan. Lors des élections vénézuéliennes en août, Antony Blinken s’est empressé de féliciter le candidat de droite Edmundo González, avant que le porte-parole Matthew Miller ne rétracte ces propos quelques jours plus tard. Aujourd’hui, l’ambassadeur américain au Mexique, qui avait déjà fait la une du New York Times en 2022 pour s’être soi-disant « trop rapproché » de AMLO, a été contraint de ravaler ses mots et de contredire ses déclarations, tout en l’espace d’une semaine.
L’un des suspects est la Drug Enforcement Administration (administration de lutte contre la drogue des États-Unis), qui a mené une opération de diffamation contre AMLO à travers des médias malléables, suite à une limitation de ses pouvoirs sur sol mexicain imposée par celui-ci. Les pions de Blinken au département d’État ou une autre agence de renseignement sont d’autres suspects. Une raison plus évidente derrière le changement de discours, cependant, est le milieu des affaires, qui se sert depuis longtemps de juges amicaux et abuse de procédés juridiques tels que amparo (une forme d’injonction préliminaire) afin de promouvoir ses propres intérêts dans des domaines stratégiques tels que la banque, l’exploitation minière, l’énergie et l’eau, ainsi que bloquer toute législation qui chercherait à les réglementer. Malgré toutes les mises en garde alarmistes sur l’influence croissante des cartels qui découlerait d’un système judiciaire démocratiquement élu, la véritable préoccupation des multinationales réside plutôt dans l’entrave que ce système mettrait à leurs intérêts monétaires, leurs pots-de-vin, et la relation jusqu’alors confortable qu’elles ont entretenue avec les juges et qui leur a pratiquement garanti des décisions en leur faveur.
Lorsque AMLO s’est battu pour accroître le contrôle public sur le secteur énergétique mexicain malgré une multitude d’amparos et une guerre juridique, Salazar, un défenseur de longue date des grandes entreprises énergétiques, tant au sein du gouvernement qu’en dehors, a également été appelé à exprimer ses « graves préoccupations » et à menacer que les divergences des deux pays sur la question « pourraient ne pas avoir de solution ». La loi visant à contrôler l’énergie privée a finalement été rejetée par la Cour suprême en février, au terme d’un procédé complexe qui n’a nécessité que les votes de deux de ses onze juges, au motif qu’elle violait la « libre concurrence » et le « développement durable ». L’ambassadeur-lobbyiste avait gagné. AMLO était déterminé à ne pas laisser cela se reproduire.
La mauvaise conduite des juges
La fureur suite à la réforme énergétique n’était que la pointe de l’iceberg. Même avant de devenir une machine à abolir des lois au moindre prétexte (74 jusqu’à présent, durant cette administration), la justice mexicaine était déjà notoire pour être un club fermé caractérisé par des salaires excessifs, des privilèges, des scandales éthiques et du népotisme au service de l’oligarchie et d’autres intérêts douteux. Ceci se manifeste sous de multiples formes, comme l’annulation de dettes fiscales, à l’instar de l’« ajustement » de 640 millions de peso (32 million US$) accordé à Totalpay, la compagnie de télécommunication détenue par la troisième personne la plus riche du Mexique et évadé fiscal notoire, Ricardo Salinas Pliego. Une autre forme est la « carte sortie de prison » permettant aux accusés aisés de s’en tirer impunément, ou, au pire, d’être renvoyé chez eux et d’être jugés depuis une assignation à résidence bien confortable. Un divertissement macabre au Mexique consiste à attendre de voir quel nouvel individu fortuné sera envoyé par la porte tournante, généralement le samedi (d’où le terme sabadazo) quand la couverture médiatique est moindre et que les bureaux du gouvernement sont fermés.
Parmi les nombreux bénéficiaires notoires figurent des noms tels que : Emilio Lozoya, accusé de triangulation d’argent de la compagnie brésilienne Odebrecht vers la campagne d'Enrique Peña Nieto ; Rosario Robles, accusé d’avoir fait transiter des millions de fonds de développement social par les universités de l’administration Peña dans ce qui était connu sous le nom de « Master Scam » ; Fransisco García Cabeza de Vaca, l’ancien gouverneur de Tamaulipas qui s’est vu retirer son immunité pour répondre à des accusations de blanchiment d’argent et de crime organisé, avant que la cour suprême n’intervienne et annule la procédure, lui permettant de fuir pour le Texas ; et le plus récent, Mario Marín, l’ancien gouverneur de Puebla, accusé d’ordonner la torture de la journaliste Lydia Cacho pour avoir révélé sa participation présumée à un réseau de pornographie et de trafic infantile. Le traitement réservé à ces figures est particulièrement choquant dans un contexte où des milliers de Mexicains sans contact ni fortune croupissent en prison pendant des années avant que leur dossier ne soit jugé.
De plus, le comportement erratique et sournois des juges au cours des derniers mois n’a fait qu’aggraver la situation. En mai, il a été révélé que la présidente de la Cour suprême Norma Piña avait tenu une réunion privée avec des magistrats du tribunal électoral fédéral en compagnie d'Alejandro Morena, le président du parti d’opposition, le parti révolutionnaire institutionnel.
Cette réunion était inquiétante pour deux raisons : premièrement, elle a impliqué des chefs de l’opposition, deuxièmement plusieurs des magistrats en charge de décider la validité de l’élection 2024 imminente y ont également pris part. D’après des conversations Whatsapp de la réunion fuitées, Piña a explicitement présenté Moreno come son « allié » et « ami » auprès des autres convives. A la place de démissionner, action aisément justifiée par la gravité du conflit d’intérêt, Piña a mené la charge contre la réforme judiciaire, à tel point que, récemment, la Cour s’est jointe à un arrêt de travail de la branche judiciaire en guise de protestation.
Comme si cela ne suffisait pas, deux juges fédéraux ont tenté d’utiliser l’injonction amparo contre le Congrès lui-même, lui ordonnant de geler l’examen de la réforme et, si elle venait à être approuvée, de s’abstenir de la soumettre à la ratification des assemblées législatives des états ; en somme, un abus judiciaire ridicule et tout à fait illégal, qui n’a fait que renforcer l’argument de MORENA sur la nécessité d’une réforme radicale. Au beau milieu de tout cela a éclaté le scandale de Lourdes Mendoza, chroniqueuse au journal El Financiero, qui a envoyé son article sur la réforme à la juge de la Cour suprême Margarita Rios-Farjat pour son feu vert, servant de rappel opportun de la relation copain-copain entre les tribunaux et les grands médias, tous à la poursuite d’intérêts communs.
La peur d’un bon exemple
En tant que premier pas vers des Cours moins corrompues, la réforme judiciaire prévoit l’élection au suffrage de la moitié des juges fédéraux en 2025, y compris l’ensemble de la Cour suprême. Tous les juges actuels pourront se présenter. Les élections seront non partisanes et l’utilisation de fonds privés sera interdite. À la place, les candidats bénéficieront de temps d’antenne et de radio gratuit pour plaider leur cause. Des comités techniques seront mis en place dans les deux chambres du congrès pour garantir la qualification des participant∙e∙s en termes d’éducation et d’expérience. Les mandats pour la Cour suprême seront réduits de 15 à 12 ans, la parité des genres sera appliquée et une limitation de la durée excessive des procès sera mise en place. Les salaires exorbitants, avantages et retraites seront supprimés. L’utilisation de l’amparo pour bloquer tout et n’importe quoi sera limitée. Enfin, un conseil de supervision indépendant capable de sanctionner, suspendre, voire révoquer les juges corrompus sera mis en place.
Bien que la réforme judiciaire soit devenue un bouc émissaire, il est important de la considérer dans le contexte des autres amendements constitutionnels que le congrès mexicain va considérer dans les mois à venir, notamment une autonomie plus importante pour les peuples indigènes et afro-mexicains, des meilleures protections en matière de salaire, de logement et de retraite, ainsi qu’une interdiction de la fracturation hydraulique, de l’exploitation minière à ciel ouvert et du maïs OGM destiné à la consommation humaine. Il n’est donc pas étonnant que les multinationales et leurs porte-paroles dans les ambassades soient inquiets. Non seulement, les réformes vont-elles limiter leur capacité à agir impunément avec le soutien des tribunaux, elles provoquent aussi une crainte qu’un tel précédent ne s’étende à des pays comme les États-Unis, qui commencent tout juste à entreprendre leur propre tentative, bien plus modeste, de réformer une Cour suprême incontrôlée et démesurée. « La peur d’un bon exemple », comme le dit si bien le journaliste et activiste Eugene Puryear.
Kurt Hackbarth est un écrivain, dramaturge et le co-fondateur du projet médiatique indépendant « MexElects ». Il est actuellement en train d’écrire un livre sur l’élection mexicaine de 2018 en tant que co-auteur.