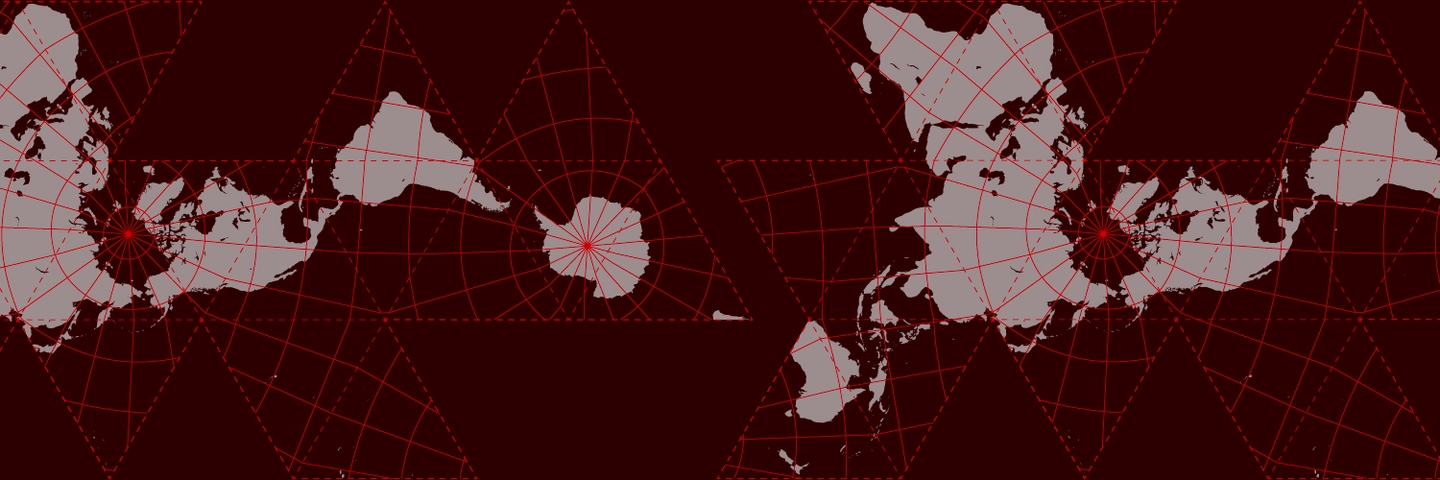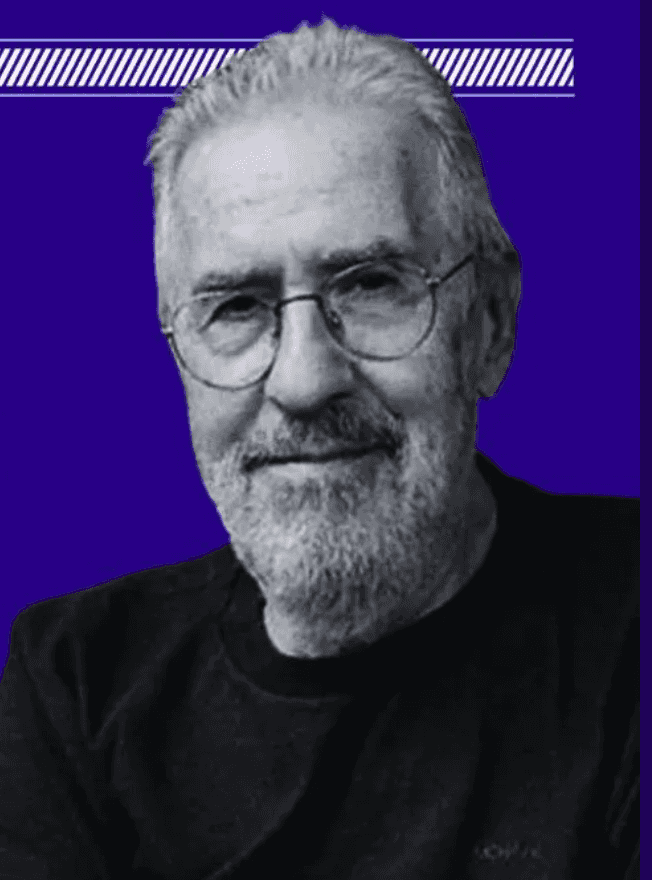
Avec la présence des navires de guerre américains le long de la côte vénézuélienne et la formation d’un nouveau bloc régional de droite sous la tutelle de Washington, l’hémisphère occidental entre dans une phase d’instabilité. Pourtant, les récents affrontements suggèrent un monde très différent de celui qui a permis par le passé aux États-Unis de dicter librement leur politique dans la région. L’essor de la Chine, la résurgence des gouvernements progressistes dans certains pays clés de la région, et le succès de projets politiques tels que la Révolution bolivarienne, ont sapé l’autorité de l’Oncle Sam. Dans ce paysage politique en pleine mutation, peu d’analystes ont su rester aussi pertinents et lucides que le penseur marxiste argentin Atilio Borón.
Dans le présent article, ce dernier nous offre une lecture générale et alarmante de l’escalade actuelle : pourquoi le Venezuela demeure une cible stratégique, par quels moyens Washington cherche à redistribuer les cartes du continent, et quelles leçons peuvent être tirées de l’héritage politique et pédagogique laissé par Hugo Chávez. Cette analyse couvre à la fois les dangers engendrés par la situation actuelle, ainsi que les forces en présence qui pourraient dissuader l’impérialisme américain de préparer une opération militaire de plus grande envergure.
Comment interprétez-vous la situation actuelle du continent, et plus particulièrement la récente opération militaire menée par Washington dans les Caraïbes ?
L’Amérique latine a toujours été perçue comme un continent contesté, et cette dispute atteint aujourd’hui son paroxysme. En effet, la région est désormais au cœur d’une lutte à l’échelle planétaire, dans le cadre de laquelle les États-Unis cherchent à réaffirmer leur domination face à de nouveaux acteurs qui gagnent du terrain.
Pendant des décennies, Washington a grandement misé sur son « soft power » pour asseoir son contrôle sur l’hémisphère. Cependant, la situation à laquelle nous assistons aujourd’hui s’apparente à une démonstration de force militaire brute. Je dirais même, bien que ce point nécessite une étude plus approfondie, que c’est la plus grande opération militaire navale jamais entreprise par les États-Unis dans la région depuis octobre 1962 et la crise des missiles cubains.
Pourquoi cette opération ? Car le système mondial connaît actuellement une transformation drastique. Un retour vers le paysage géopolitique d’il y a quinze années n’est plus envisageable. Prenons l’exemple de la Chine : à la fin du 19e siècle, voire jusqu’au début du 20e siècle, très peu d’analystes américains voyaient en ce pays une menace. Je me souviens du jour où j’ai assisté à un grand séminaire international organisé à Buenos Aires à la fin des années 1980, lors duquel les économistes américains ne prévoyaient un réveil de la Chine qu’aux alentours des années 2030. L’Histoire leur a prouvé tout le contraire.
Analysons les chiffres. En 2000, les échanges commerciaux entre la Chine et la région regroupant l’Amérique latine ainsi que les Caraïbes représentaient environ 12 milliards de dollars par an. En 2005, l’année de l’échec de l’accord sur une zone de libre-échange des Amériques initié par les États-Unis lors du Sommet de Mar del Plata, ce chiffre a explosé jusqu’à atteindre les 50 milliards de dollars. La Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (ECLAC) rapporte un total de 538 milliards de dollars en 2024. Cette simple réalité suffit à expliquer pourquoi nous pouvons résumer la politique étrangère américaine de ces dernières années en trois mots : isoler la Chine.
Toutefois, Washington ne parvient plus à contenir ce nouveau concurrent, hissé au rang de premier partenaire commercial du Brésil, du Chili, et bientôt de la Colombie, ainsi que de deuxième exportateur vers le Mexique et l’Argentine. De plus, au niveau mondial, la Chine entretient des liens économiques privilégiés avec plus de 140 pays, que ce soit à travers des échanges commerciaux, des investissements, ou bien les deux. La Chine compte bien se faire une place.
L’Inde enregistre également une présence grandissante dans la région, bien que moindre, tandis que la Russie joue un rôle majeur dans des projets d’infrastructures et de défense entrepris au sein de plusieurs pays. Toutes ces récentes évolutions se produisent dans une région extraordinairement riche en ressources naturelles, des ressources dont les États-Unis ont grandement besoin.
Prenons le cas des terres rares. Près de 80 % des réserves mondiales recensées se trouvent en Chine, et ce pays contrôle quasiment les 90 % de la capacité de traitement mondiale. Certains pays d’Amérique latine, dont le Chili, l’Argentine, le Brésil, et même le Venezuela, disposent de réserves plus modestes qui attirent la convoitise de Washington.
Dans quelle mesure ces nouveaux rapports de force mondiaux influencent la stratégie menée par Washington en Amérique latine et dans les Caraïbes ?
Il est d’abord important de bien comprendre la nouvelle situation qui se dessine dans la région. Contrairement aux années 2000, à l’époque où des gouvernements progressistes s’étaient ouvertement opposés d’une seule voix à l’ordre impérialiste, le paysage politique actuel est plus mitigé. Nous assistons certes à une résurgence des mouvements conservateurs, mais l’ancien statu quo n’a jamais été totalement restauré, ce qui a permis à une nouvelle dynamique progressiste de faire son apparition.
Le Mexique impose aujourd’hui des limites prudentes, mais non négligeables, à la pression exercée par les États-Unis. Pour la première fois en deux siècles, la Colombie est dirigée par un gouvernement populaire sous la présidence de Gustavo Petro. Le Honduras est gouverné par Xiomara Castro, et le prochain candidat issu de son parti, Rixi Moncada, est en tête des intentions de vote. Le Venezuela continue de résister contre toute attente, malgré le poids énorme des mesures coercitives unilatérales imposées au pays. Cuba demeure le modèle à suivre pour la région en matière de lutte contre l’impérialisme américain.
Washington cherche activement à former un nouvel axe anti-Venezuela, anti-Cuba et anti-Nicaragua. Pour y parvenir, celle-ci s’appuie grandement sur des figures telles que le président argentin Javier Milei, Nayib Bukele au Salvador, ainsi que le président équatorien Daniel Noboa, accusé d’entretenir des liens avec des organisations narcoterroristes.
Ce que certains qualifient de « mini-ZLEA » n’est autre qu’un accord de libre-échange entre l’Argentine, l’Équateur, le Salvador, le Guatemala et, bien évidemment, les États-Unis. C’est en réalité bien plus qu’un simple accord commercial, que l’on peut qualifier d’accord dicté unilatéralement. Parmi les dix-neuf dispositions contraignantes approuvées, seize ont été adoptées à l’initiative de Washington. Une disposition autorise notamment l’exportation de bétail vivant des États-Unis vers l’Argentine, une absurdité pour un pays dont l’identité repose en partie sur l’industrie bovine.
Malgré toutes les tentatives désespérées de s’accaparer les marchés libres, l’objectif réel de Washington est sans équivoque : le lithium, les terres rares et les hydrocarbures. Toute autre prétention passe au second plan.
Pourquoi le Venezuela constitue-t-il une cible essentielle pour Washington, et que se cache-t-il derrière la récente escalade militaire initiée par les États-Unis ?
Les États-Unis ont toujours considéré le Venezuela comme une préoccupation de premier ordre en matière de sécurité. Les entreprises pétrolières américaines ont historiquement joué un rôle décisif dans l’exploitation des réserves de pétrole vénézuéliennes, mais l’arrivée au pouvoir d’Hugo Chávez a tout changé. Ces entreprises ont ensuite perdu davantage de terrain à la suite du blocus mis en place par les États-Unis contre le pays.
Aujourd’hui, les marchés pétroliers mondiaux n’ont jamais été aussi stratégiques, et les études géologiques confirment que le Venezuela détient les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde… encore plus grandes que celles de l’Arabie Saoudite !
Ces réserves présentent un avantage stratégique supplémentaire : elles ne sont qu’à quatre ou cinq jours de trajet des raffineries américaines, contre près de vingt-cinq jours nécessaires pour acheminer le pétrole provenant du Golfe Persique. Cet avantage rend l’acheminement moins coûteux et plus sûr, étant donné que les États-Unis détiennent près de quarante bases militaires aux Caraïbes. Avec de tels avantages en jeu, il n’est pas surprenant que la politique de nationalisation de l’industrie pétrolière entreprise par la Révolution bolivarienne, ainsi que la souveraineté nationale prônée par cette dernière, agace au plus haut point Washington.
L’Oncle Sam a tenté toutes les mesures imaginables pour briser le Venezuela : les guarimbas de 2014 et de 2017 ; les sanctions unilatérales qui ont causé la mort de milliers de citoyens ; la farce dénommée « Juan Guaidó », uniquement célèbre grâce à son absurdité, ayant toutefois permis la spoliation d’actifs vénézuéliens dont Citgo ; et maintenant le prix Nobel de la honte décerné à María Corina Machado, une figure qui se nourrit de cette violence politique.
Après avoir échoué sur tous les fronts, Washington se tourne maintenant vers la solution militaire, qui est tout aussi complexe à mettre en œuvre. En 1989, les États-Unis ont déployé 26 000 marines lors de l’invasion du Panama visant à destituer Noriega, et il leur a quand même fallu un mois entier pour s’emparer de Panama City.
L’idée d’une invasion au Venezuela semble absurde, et les analystes américains en sont probablement conscients. Pourtant, Washington pourrait adopter une stratégie inspirée de son allié israélien, consistant à cibler des infrastructures stratégiques telles que le barrage de Guri, des raffineries ou encore des aéroports, et ce dans le but de causer des dégâts significatifs. Cette approche présente néanmoins quelques limites : si les États-Unis comptent s’emparer du pétrole vénézuélien, il faudrait éviter de détruire l’ensemble des infrastructures énergétiques du pays lors de ces opérations.
L’instabilité et la témérité de Trump rendent la situation particulièrement dangereuse. Ses déboires personnels et juridiques, notamment ses liens documentés avec Jeffrey Epstein, ont sapé la confiance que beaucoup portaient en lui, même au sein du parti républicain.
Compte tenu de ce scénario, le Venezuela doit faire appel à la solidarité internationale ainsi qu’à une action politique décisive. La Chine, en particulier, devrait répondre à l’escalade navale américaine entreprise dans les Caraïbes par un déploiement de ses propres navires au large de Taïwan, sans tirer le moindre coup de feu. Une telle action enverrait un message limpide : toute agression ne restera pas sans réponse. Si Washington attaque le Venezuela aujourd’hui, rien ne l’empêchera de s’en prendre à la Chine dans le futur. Il est donc essentiel d’adresser un avertissement dissuasif pour la sécurité des deux pays.
Quelle importance revêt l’héritage d’Hugo Chávez en cette période rythmée par les agressions impérialistes ?
Chávez est une figure extraordinaire de l’histoire contemporaine, non seulement pour le Venezuela, mais aussi pour notre continent et le monde entier. Il a perpétué l’héritage de Simón Bolívar ainsi que la vision émancipatrice des mouvements indépendantistes latino-américains en restaurant les principes de souveraineté nationale et d’autodétermination, à un moment où ces derniers battaient gravement de l’aile.
L’éducation politique fournie au peuple vénézuélien, que ce soit à travers le programme télévisé Aló Presidente ou par le biais de ses innombrables interventions publiques, demeure l’une de ses plus grandes réussites. Il a surtout su montrer l’exemple à son peuple. Ceci explique entre autres le succès populaire qu’a rencontré le récent appel à l’enrôlement volontaire auprès de la milice nationale vénézuélienne. Il n’est jamais simple de demander à ses concitoyens de risquer leur vie pour leur pays, mais Chávez (et maintenant Maduro) a réussi, car El Comandante a planté une graine dont les racines sont profondément ancrées dans l’idéal de la Patria Bonita : une patrie aimée et honorée.