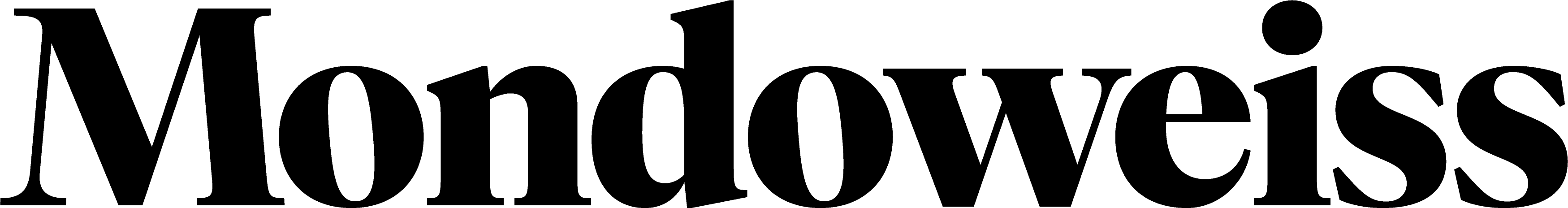Note de l'éditeur : Ceci est une version abrégée d'un article publié à l'origine par notre partenaire, The Nation. Vous pouvez lire la version complète en anglais ici.
Au moins quatre hommes armés de machettes et de gourdins ont pénétré par effraction au domicile d'Anne Johnson. Ils ont forcé son mari et son fils de 11 ans à aller dans la chambre et ont gardé Anne et ses filles adolescentes dans une pièce séparée. À ce jour, elle ne sait pas avec certitude si les hommes qui l'ont violée elle, son mari et ses filles étaient ses collègues de travail. « Ils parlaient la langue locale », a témoigné Anne, mais « ils nous ont bandé les yeux pour que nous ne puissions pas voir qui ils étaient ».
En 2007, lorsque l'attaque a eu lieu, Anne et son mari Makori (leurs noms sont des pseudonymes pour protéger la famille de représailles) vivaient et travaillaient depuis plus de dix ans dans une plantation de thé kenyane appartenant à Unilever, le géant des articles ménagers basé à Londres, connu pour des marques comme Lipton Tea, Dove, Axe, Knorr et les glaces Magnum. En décembre de cette année-là, des centaines d'hommes de la ville voisine de Kericho ont battu, mutilé, violé et massacré les habitant·e·s de la plantation au cours d’une semaine de terreur.
Les agresseurs ont tué au moins 11 habitant·e·s de la plantation, dont Makori, qu'ils ont violé et mortellement blessé devant son fils, et une des filles de la famille Johnson. Ils ont pillé et brûlé des milliers de maisons et ont blessé et agressé sexuellement un nombre indéfini de personnes, qui ont été ciblées en raison de leur identité ethnique et de leur affiliation politique présumée.
C’est une élection présidentielle contestée qui a déclenché la violence. Le candidat ayant les faveurs de la population locale de Kericho - et ouvertement soutenu par de nombreux·ses dirigeant·e·s d'Unilever - a perdu face à l'homme politique perçu comme ayant le soutien de tribus minoritaires. Le massacre ne s'est pas limité à la plantation ou à Kericho : plus de 1 300 personnes à travers le Kenya sont mortes dans ces violences post-électorales.
Unilever a déclaré que les attaques sur sa plantation étaient inattendues et qu'elle ne pouvait donc pas être tenue pour responsable. Mais des témoins et d'ancien·ne·s dirigeant·e·s d'Unilever affirment que les propres employés de l’entreprise ont incité et participé aux attaques. Iels ont fait ces allégations en 2016 par le biais d’un témoignage écrit, après que l'affaire a été soumise à un tribunal de Londres. Anne et 217 autres survivant·e·s voulaient qu'Unilever Kenya et sa société-mère au Royaume-Uni leur versent des réparations. Parmi les plaignant·e·s figuraient 56 femmes violées et les membres des familles de sept personnes tuées.
Dans des centaines de pages de témoignages et d'autres documents judiciaires, ainsi que dans des entretiens que j'ai menés, les survivant·e·s décrivent comment, à l'approche de l'élection, leurs collègues les ont menacé·e·s de les attaquer si le « mauvais » candidat gagnait. Lorsqu'iels ont fait remonter ces commentaires, leurs supérieur·e·s ont rejeté leurs préoccupations, ont proféré des menaces à peine voilées ou ont fait elleux aussi des remarques désobligeantes.
D'ancien·ne·s dirigeant·e·s d'Unilever Kenya ont admis devant la Cour que les cadres supérieur·e·s de la société, y compris le directeur général de l'époque, Richard Fairburn, avaient discuté de la possibilité de violences électorales lors de plusieurs réunions mais n'avaient amélioré la sécurité que pour les hauts responsables, les usines et le matériel.
Unilever Kenya insiste sur le fait qu'elle n'est pas responsable et reproche à la police d'avoir agi trop lentement. Pendant ce temps, la société-mère à Londres maintient qu'elle ne doit rien aux travailleur·euse·s et que les victimes devraient poursuivre l'entreprise au Kenya, et non au Royaume-Uni. Mais les travailleur·euse·s affirment qu'un procès au Kenya pourrait déclencher davantage de violence, y compris de la part de leurs anciens agresseurs, dont certains travaillent toujours à la plantation.
En 2018, un juge du Royaume-Uni a décidé que le siège londonien d'Unilever ne pouvait être tenu responsable des échecs de sa filiale kenyane. Aujourd'hui, Anne et ses ancien·ne·s collègues se tournent vers le Groupe de travail des Nations unies sur les entreprises et les droits humains, qui devrait décider dans les prochains mois si Unilever a oui ou non respecté les directives des Nations unies en matière de conduite responsable des entreprises. Comme Anne me l'a expliqué, « l’entreprise avait promis de s'occuper de nous mais elle ne l'a pas fait, alors maintenant elle devrait nous payer pour que nous puissions enfin reconstruire nos vies ».
En 2007, la plantation de thé d'Unilever, située dans les collines de la vallée du Rift, au sud du Kenya, couvrait environ 13 000 hectares. Avec une population d'environ 100 000 personnes, dont 20 000 travailleur·euse·s et leurs familles, et des écoles, des cliniques et des services sociaux sur place, les plantations s’apparentent à une ville-entreprise, qui plus est cosmopolite : les travailleur·euse·s appartiennent à des ethnies issues de tout le pays.
La famille Johnson est originaire de Kisii, un comté situé à deux heures de route des domaines d'Unilever, et s'identifie ethniquement comme Kisii. Sur la plantation, les Kisiis représentaient près de la moitié des habitant·e·s, mais dans le Kericho voisin - la patrie d'un groupe ethnique appelé les Kalenjin - iels constituaient une minorité beaucoup plus réduite. Et beaucoup de gens à Kericho méprisaient les Kisiis et les autres « étranger·ère·s ». La plantation reflétait cette division : les Kalenjins étaient principalement des cadres, et les Kisiis et autres minorités travaillaient pour la plupart comme cueilleur·euse·s de thé.
Le couple a passé le dernier dimanche de décembre 2007 comme n'importe quel autre jour : dans le champ avec un panier sur le dos, bien qu'iels s'attendaient à ce que la soirée soit tendue, puisque les résultats de l'élection seraient annoncés en fin d'après-midi. Plus tôt dans la semaine, des millions de Kenyan·e·s s'étaient rendu·e·s aux urnes pour choisir leur nouveau président dans une élection opposant Raila Odinga, qui dirigeait le Mouvement démocrate orange (ODM) à Mwai Kibaki, du Parti de l'unité nationale (PNU).
Anne n'avait elle-même pas voté. Quelques semaines plus tôt, elle avait demandé une autorisation pour se rendre à Kisii, où elle était inscrite sur les listes électorales, mais son responsable avait refusé la demande, a-t-elle déclaré. Cette expérience était courante pour les membres des tribus minoritaires, a expliqué Daniel Leader, avocat et associé du cabinet d'avocat·e·s londonien Leigh Day, qui a représenté les survivant·e·s au tribunal et dont l'équipe a interrogé les 218 plaignant·e·s.
Les élections imminentes ont exacerbé les tensions entre les travailleur·euse·s Kalenjin d'Unilever et leurs collègues Kisii, plus jeunes. « Iels ont supposé que nous, les Kisiis, soutenions Mwai », a expliqué Anne, alors que la population locale de Kalenjin était majoritairement pro-Odinga.
Dans les semaines qui ont précédé l'élection, les survivant·e·s affirment que le personnel qui soutenait le MDO a transformé les plantations de thé en un espace férocement pro-Odinga, en organisant des rassemblements politiques et des réunions stratégiques sur la propriété. Anne m'a dit que la perception des Kisiis comme des partisan·e·s de Kibaki a conduit certain·e·s Kalenjins à les traiter avec hostilité. Elle disait que les chef·fe·s d'équipe, par exemple, ont commencé à attribuer des tâches à des travailleur·euse·s non-Kisiis. D'autres collègues ont complètement cessé de lui parler. Au grand désarroi d'Anne, elle a trouvé des tracts avec des slogans haineux comme « étranger·ère·s, rentrez chez vous » dans les zones résidentielles, ce qui lui faisait craindre que « quelque chose de mauvais puisse arriver après les élections ».
Anne a eu peur mais s'est tue. « L'entreprise est si grande. Je pensais qu'iels nous protégeraient », m'a-t-elle dit. Selon les survivant·e·s, celleux qui ne se sentaient pas rassuré·e·s et qui demandaient la protection de leurs chef·fe·s d'équipe et de leurs directeur·rice·s ont été accueilli·e·s avec indifférence. Lors des témoignages au tribunal, beaucoup se sont souvenu·e·s que divers directeur·rice·s avaient ignoré leurs demandes de sécurité ou les avaient rejetées en disant : « C'est juste de la politique ». D'autres directeur·rice·s ont demandé aux travailleur·euse·s concerné·e·s de faire pression et de voter pour Odinga, en ajoutant qu'iels seraient « obligé·e·s de partir » s'iels ne le faisaient pas.
Un gestionnaire immobilier a admis devant le tribunal de Londres que les cadres supérieur·e·s d'Unilever Kenya - y compris le directeur général Fairburn - avaient été conscient·e·s qu' « il y aurait des troubles et que la plantation pourrait être envahie ». Iels avaient discuté de la nécessité de sécurité supplémentaire lors d'au moins trois réunions en décembre, a-t-il déclaré. Mais la direction n'a pris des mesures que pour « sécuriser les biens de l'entreprise, les usines, les machines, les magasins, les centrales électriques et les logements de la direction », alors que « l'on n'a pas pensé à renforcer la sécurité des camps résidentiels afin de protéger les travailleur·euse·s ». Un·e autre ancien·ne directeur·rice d'Unilever a corroboré cette affirmation.
Fairburn, qui y aurait assisté, a refusé de commenter les réunions lorsque je l'ai appelé. À ce jour, Unilever affirme qu'il n'aurait pas pu prévoir les attaques, même si les médias au Kenya et à l'étranger, y compris la BBC, Al Jazeera, le New York Times et Reuters, avaient fait état de l’imminence de la violence ethnique.
« Quiconque connaissait quelque chose aux élections kenyanes de 2007 savait qu'elles risquaient de se solder par des violences importantes et généralisées, et que ces violences porteraient en grande partie sur des critères d'identité et d'affiliation », a déclaré Tara Van Ho, qui enseigne le droit et les droits humains à l'université d'Essex. Tant Unilever Kenya que sa société-mère à Londres auraient dû savoir que les travailleur·euse·s et leurs familles étaient en danger, a-t-elle poursuivi. Pour les protéger, a-t-elle fait valoir, Unilever aurait pu engager des agent·e·s de sécurité supplémentaires, former son personnel de sécurité et ses cadres, et renforcer leurs bâtiments ou évacuer les habitant·e·s pour la période d'élection.
Au lieu de cela, a déclaré Me Leader, l'avocat londonien des travailleur·euse·s, Unilever « a créé une situation où [ces employé·e·s] étaient des cibles faciles, en danger à cause de leur origine ethnique ».
Pendant ce temps, le directeur général d'Unilever Kenya et d'autres cadres sont parti·e·s en vacances avant la crise, selon les ancien·ne·s dirigeant·e·s, et la société a évacué les cadres restant·e·s et les expatrié·e·s par jets privés une fois que la violence a éclaté.
Lorsque la nouvelle de la victoire de Kibaki est arrivée dimanche soir, Anne préparait le dîner avec sa famille. Quelques instants plus tard, elle a entendu des gens crier dehors et a su qu'iels étaient en danger. « Nous avons rapidement fermé nos portes à clé », dit-elle.
Cette nuit-là, des centaines d'hommes armés de machettes, de gourdins, de bidons de kérosène et d'autres armes ont envahi la plantation. Ils ont pillé et brûlé des milliers de maisons Kisii - qu'ils ont marquées d'un X - et ont attaqué leurs habitant·e·s.
Les dossiers de la Cour brossent un tableau déchirant de ce qui s'est passé sur la plantation au cours de la semaine suivante. Les gens ont été victimes de viols collectifs, ont été violemment battu·e·s et ont vu leurs collègues être brûlé·e·s vif·ve·s. Lorsqu'iels se sont enfui·e·s vers les arbres à thé pour se mettre à l'abri, les agresseurs les ont poursuivi·e·s à l’aide de chiens.
« Nous ne connaissons pas le nombre total de personnes qui ont été violées, tuées ou qui seront handicapées à vie », m'a dit Leader. Il pense que les 218 plaignant·e·s qu'il a représenté·e·s ne sont pas les seules victimes survivantes. « Beaucoup de gens ont trop peur des représailles ou de nouvelles attaques de la part de collègues avec lesquels iels continuent à travailler », a-t-il déclaré.
La crainte de représailles violentes était l'une des raisons pour lesquelles les survivant·e·s voulaient poursuivre Unilever au Royaume-Uni. Une autre raison était que Leigh Day les représentait gratuitement, alors qu'au Kenya les survivant·e·s n'auraient pas les moyens de payer un·e avocat·e.
Leigh Day a fait valoir que leurs client·e·s kenyan·e·s avaient le droit de poursuivre Unilever à Londres, puisque la loi britannique permet aux travailleur·euse·s des filiales internationales de poursuivre les sociétés-mères basées au Royaume-Uni si, entre autres, iels peuvent démontrer que la société mère joue un rôle actif et de contrôle dans la gestion quotidienne de la filiale. Pour Unilever, selon Leigh Day, c’était clairement le cas.
Les avocat·e·s d'Unilever ont néanmoins insisté pour que les victimes déposent leur plainte au Kenya et ont suggéré que les cueilleur·euse·s de thé « se regroupent » et « collectent des fonds auprès de leurs ami·e·s et de leur famille ».
De nombreuses victimes ont déclaré avoir identifié leurs agresseurs comme étant des collègues d'Unilever. Une femme a déclaré au tribunal qu'elle avait été attaquée par cinq de ses collègues, qu'elle a identifiés par leur nom. Les hommes « ont commencé à me battre avec une barre en métal sur le dos et les jambes et allaient me violer », a-t-elle déclaré dans son témoignage, jusqu'à ce qu' « un voisin Kalenjin qui était infirmier intervienne pour arrêter l'attaque ».
Au tribunal, Unilever a nié que son propre personnel ait participé aux attaques. Mais lorsque j'ai demandé aux représentant·e·s d'Unilever comment la société le savait, iels ont refusé de commenter davantage cette question.
Après le départ des agresseurs, les membres de la famille Johnson ont fui et se sont caché·e·s pendant trois nuits dans les arbres à thé avant de se rendre au poste de police de Koiwa, tout proche, couvert·e·s de boue et de sang. A partir de là, des policier·ère·s les ont escorté·e·s en lieu sûr, et la famille a pu s'enfuir à Kisii où iels avaient un petit lopin de terre. Sans économies, iels ne pouvaient pas payer les frais d'hôpital de leur fille aînée, qui souffrait de graves blessures et s'affaiblissait de jour en jour, ni ceux de Makori, qui souffrait d'une hémorragie interne. Dans les mois qui ont suivi, toutes deux sont mortes dans leur maison en pisé à Kisii.
Anne a déclaré que les seuls messages qu'elle avait reçu d'Unilever depuis les attaques étaient une invitation à retourner au travail quelques mois plus tard et une lettre lui offrant environ 110 dollars de compensation. La lettre suggère que ce montant a été fixé et payé par le siège social d'Unilever à Londres.
« Au nom de toute la famille d'Unilever Tea Kenya Ltd », on peut y lire : « Nous remercions Unilever pour sa compréhension, son soutien matériel et moral et nous espérons que ce geste bienvenu contribuera grandement à ramener la normalité pour nos employé·e·s et leurs familles ».
Anne m'a dit qu'elle n'était jamais retournée à la plantation parce qu'elle ne pouvait pas laisser son fils, qui a maintenant la vingtaine. « Il a fait de très graves crises et des attaques de panique après ce qui s'est passé et a un besoin constant de soins », a-t-elle déclaré. Gravement traumatisé·e·s et incapables de se payer le traitement psychologique dont iels ont besoin, son fils et sa fille ont tou·te·s deux cessé d'aller à l'école. « Nous vivons des cadeaux de nos parents et voisin·e·s et du peu de maïs que nous cultivons sur nos terres », dit-elle.
Les plaignant·e·s affirment qu'Unilever leur doit des réparations significatives, mais Unilever insiste sur le fait qu'il les a déjà indemnisé·e·s. Les porte-paroles de la société m'ont dit que celle-ci avait rétribué tous les travailleur·euse·s qui étaient finalement retourné·e·s à la plantation avec de l'argent et de nouveaux meubles, et avait également offert à leurs familles des thérapies et soins médicaux gratuits. Mais iels ne veulent pas dire combien la compagnie leur a donné ni commenter la lettre qu'Anne m'a fait parvenir.
Au cours de l'été 2018, Anne et un groupe d'autres victimes ont réfuté ces affirmations dans une lettre adressée à Paul Polman, le PDG de la société à l'époque : « Il n'est pas juste qu'Unilever ait dit qu'il nous avait aidé·e·s alors que nous savons que ce n'est pas vrai », peut-on lire dans la lettre. La lettre se poursuit :
Unilever voulait juste que nous retournions au travail comme si rien ne s'était passé [et celleux d'entre nous qui l'ont fait] se sont vu·e·s intimer de ne pas parler de ce qui s'est passé. Nous avons toujours peur d'être puni·e·s si nous parlons de la violence.
Unilever dit qu'après les violences, chaque employé·e a reçu une « compensation en nature » pour compenser la perte de salaire et que nous avons reçu des objets de remplacement ou de l'argent pour acheter de nouveaux objets afin de remplacer nos biens volés... mais celleux qui avaient trop peur de revenir n'ont rien reçu et seul·e·s certain·e·s de celleux qui sont revenu·e·s ont reçu 12 000 KES [91 €], soit un peu plus d'un mois de salaire, et un peu de maïs, qui a ensuite été déduit de notre salaire. On nous a dit que si nous voyions des gens avec nos affaires, nous ne devions rien dire.
Il s’avère que Polman n'a pas répondu à cette lettre.
En vertu de la législation britannique, une société-mère ne peut être tenue pour responsable des infractions à la santé et à la sécurité de ses filiales que si elle exerce un degré élevé de contrôle sur leurs politiques de sécurité et de gestion des crises.
Pour prouver au tribunal que la société-mère britannique a effectivement exercé un tel contrôle sur Unilever Kenya, Leigh Day a présenté les dépositions d'ancien·ne·s travailleur·euse·s, qui ont témoigné des fréquentes visites effectuées par les dirigeant·e·s de Londres, et de quatre ancien·ne·s dirigeant·e·s qui ont témoigné que le siège social a façonné, supervisé et contrôlé les politiques de sécurité et de gestion de crise d'Unilever Kenya et a même rendu ses propres protocoles de sécurité obligatoires. Cela signifie que, comme l'a déclaré un·e cadre supérieur·e ayant plus de 15 ans d'expérience dans l’entreprise, Unilever Kenya était « limité à se conformer strictement aux politiques et procédures qui avaient été mises en place par [Unilever] Plc ». Un·e autre cadre supérieur·e a déclaré que les « listes de contrôle et les politiques détaillées de Londres devaient être respectées, faute de quoi un·e employé·e serait licencié·e ou serait l'objet d'une autre sanction ».
Ces témoignages semblaient soutenir l'affirmation de Leigh Day selon laquelle le siège de Londres partageait la responsabilité. Toutefois, pour le prouver au tribunal, le cabinet d'avocat·e·s avait besoin d'accéder au texte des protocoles décrits par les dirigeant·e·s. Mais comme il s'agissait de procédures préalables au procès - ce qui signifiait que le tribunal n'avait pas statué sur sa compétence -, le cabinet n'était pas tenu de divulguer les documents pertinents et a simplement refusé de les remettre.
La décision de la juge a clairement montré que la « faiblesse » de leurs preuves a joué un rôle majeur dans sa décision de refuser la juridiction aux Kenyan·e·s. Les spécialistes des droits humains et les défenseur·euse·s de la responsabilité des entreprises ont condamné cette décision. Le tribunal a créé une impasse pour les travailleur·euse·s, a fait observer Mme Van Ho : « Les plaignant·e·s ne pouvaient pas obtenir les documents qui montraient qu'Unilever UK avait fait quelque chose de mal tant qu'iels n'avaient pas les documents qui montraient qu'Unilever UK avait fait quelque chose de mal. » C'est « vertigineux », a-t-elle dit, et « un résultat injuste pour des employé·e·s qui ont beaucoup moins de pouvoir que la société multimilliardaire qui les employait ».
Anne a déclaré qu'elle garde l'espoir que les défenseur·euse·s internationaux·ales des droits humains soutiendront sa cause. Avec d'autres victimes, elle a récemment déposé une plainte contre Unilever aux Nations unies, arguant que la société violait les principes directeurs des Nations unies pour les entreprises et les droits humains. L'une des exigences est que les entreprises doivent veiller à ce que les victimes de violations des droits humains dans leur chaîne d'approvisionnement aient accès à des mesures correctives. Mme Van Ho pense que l'organe des Nations unies, qui devrait bientôt prendre une décision, reconnaîtra qu'Unilever a violé ces principes directeurs. « Se cacher derrière des échappatoires juridiques et refuser de divulguer des informations pertinentes pour éviter de payer des réparations est exactement le contraire de ce que prescrivent les principes directeurs », a-t-elle déclaré.
Bien que les Nations Unies ne puissent pas forcer Unilever à payer, Anne espère que l'affaire suscitera l'attention et la pression publique nécessaires pour pousser la société dans cette direction. Lorsqu'on lui a demandé ce que cela signifierait pour elle si les travailleur·euse·s obtenaient gain de cause, elle a répondu : « Ce serait le plus grand moment de ma vie ».
Maria Hengeveld est journaliste d’investigation spécialisée dans les droits des travailleur·euse·s et la responsabilité des entreprises, et doctorante (Gates Scholar) à King’s College (Cambridge).
Photo: Bryon Lippincott / Flickr