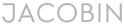Chaque hiver, Delhi disparaît dans son propre souffle. Le soleil pâlit derrière un mur gris épais ; l’horizon se brouille ; l’air a le goût de cultures brûlées et de diesel. Les gens plaisantent sur la ''saison du smog”, comme si une lente asphyxie publique était aussi naturelle que la mousson. Ceux qui peuvent partir, partent. Le reste de Delhi — ses millions de travailleurs migrants, d'agents d'entretien, de maçons, de chauffeurs, ceux qui font vivre la ville — suffoquent dans une lente défaite.
Au fil des décennies, l’Inde a perfectionné une manière de survivre aux catastrophes : les riches se contentent de s’en retirer. Quand le système de santé échoue, ils construisent leurs propres hôpitaux. Quand l’eau devient brune, nous installons des filtres à la maison et posons des canalisations privées. À chaque été brûlant, Delhi se reconstruit comme un archipel de forteresses climatisées, chacune une petite police d’assurance contre l’échec du collectif. La santé s’achète, l’éducation se privatise, l’eau s’embouteille, la sécurité se paie par des gardes privés. La capitale se transforme en un puzzle d’échappatoires — des centres commerciaux bourdonnant au-dessus d’égouts stagnants, des résidences fermées avec ascenseurs ségrégués dignes de l’apartheid, scintillant à côté des bidonvilles qui les servent.
Nous vivons par soustraction — chaque famille, chaque fortune, creusant une île habitable dans une mer en train de s’effondrer. Une logique de séparation, de pureté et de pollution qui descend de la plus ancienne grammaire du sous-continent, où le vieux tabou des castes trouve éternellement de nouvelles technologies.
Mais l’air refuse d’obéir. Il s’infiltre dans les tours vitrées, franchit les murs, entre dans chaque poumon. L’air de la ville est aujourd’hui 15 fois plus pollué que la limite de sécurité de l’Organisation Mondiale de la Santé, assez pour effacer huit ans de vie moyenne. En 2023, l’air pollué a été lié à près d’un décès sur huit dans la capitale — non pas en explosions dramatiques, mais dans l’attrition silencieuse des AVC, des maladies cardiaques, des insuffisances pulmonaires et des naissances à faible poids. L’air est le dernier bien public qui ne peut pas être acheté, mis en bouteille ou enfermé — et il empoisonne chaque enfant jouant dans un champ, riche et pauvre. Pourtant, pourquoi rien ne change ?
Le gouvernement a répondu par un théâtre rituel. Le gouvernement central accuse les agriculteurs du Pendjab ; le gouvernement de Delhi accuse son prédécesseur. Une enquête ce mois-ci a révélé que des camions-citernes arrosaient la ville non pas pour atténuer le smog, mais pour être pulvérisés sur les capteurs des stations de mesure afin d’abaisser les Indices de Qualité de l’Air — nettoyant les données plutôt que l’air.
La cheffe du gouvernement de Delhi a affirmé se tenir au bord de la Yamuna pour la Chhath Puja, trempant ses pieds dans ce qui ressemblait à un étang serein. Des photos ont ensuite montré qu’il s’agissait d’un faux ghat — un bassin artificiel rempli d’eau filtrée, isolé du fleuve pollué que le Comité de contrôle de la pollution de Delhi venait de déclarer « impropre même à la baignade ».
Cette chorégraphie n’est pas nouvelle. Pendant l’été 2021, lorsque le Gange s’est transformé en tombe, le New York Times a suggéré que le véritable bilan pandémique de l’Inde pourrait dépasser 1,6 million de morts, soit 14 fois le chiffre officiel. Mais le gouvernement a refusé de publier des données détaillées, et lorsque les chercheurs et journalistes ont commencé à analyser le Système national d'information sanitaire pour étudier l’excès de mortalité, le jeu de données a été retiré discrètement, comme l’a rappelé la journaliste de données Rukmini S. Twitter (aujourd’hui X) a été sommé de supprimer les publications critiquant la gestion gouvernementale de la crise — parmi elles des photos de crémations, des appels à l’aide pour des lits d’hôpital et des rapports de pénurie d’oxygène. L’Inde ne pouvait plus respirer, et désormais elle ne pouvait plus parler.
L’absence totale de gouvernance — et de toute attente d’obligation de rendre des comptes — définit aujourd’hui la réponse de Delhi à la pollution. La ville s’étend toujours plus haut, toujours plus loin, mais jamais ensemble. La politique est remplacée par le blâme ; la gouvernance par le spectacle.
Delhi, qui déborde de près de 30 millions de personnes, n’est le foyer de presque personne. Au cours des cinq dernières années, les prix de l’immobilier dans la région Delhi-NCR ont grimpé de plus de 80 %, tandis que les revenus n’ont que peu suivi. Selon toute norme de vie décente, le salaire minimum mensuel de 18 456 Roupies est bien insuffisant pour couvrir le coût d’un régime sain, d’un logement sûr et des dépenses courantes. Cet été, alors que les températures ont dépassé les 50 °C, repoussant les limites scientifiques de la survie humaine, des dizaines de travailleurs extérieurs sont morts d’insolation tandis que les applications modernes pressaient un précariat épuisé — livreurs pédalant dans la fournaise pour apporter eau et nourriture à des portes climatisées.
Ceux-là mêmes étaient les cibles de la « campagne de propreté » très vantée par la cheffe du gouvernement, appliquée avec férocité quelques semaines après sa prise de fonctions : bulldozers et équipes municipales chassant vendeurs ambulants, stands de nourriture de rue et petits commerçants au nom de l’embellissement — une dernière disparition des pauvres, ces mêmes pauvres que l’on avait dissimulés derrière d’immenses panneaux publicitaires lors du G20 deux ans plus tôt. Ce week-end, alors que l’air atteignait des niveaux « dangereux », des parents et des activistes réunis à India Gate pour réclamer le droit de leurs enfants à respirer ont été rapidement arrêtés par la police pour rassemblement sans autorisation.
Pourtant, l’air, malgré son poison, reste obstinément démocratique. Il circule à la fois dans le Delhi de Lutyens et les bastis, dans le Parlement comme sur les trottoirs. Il est le dernier insurgé de la ville, le dernier rappel que la nature ne négocie pas.
Mais un public si longtemps privé du sens du bien commun ne peut pas facilement comprendre ce que signifie se battre pour celui-ci. Au Brésil, une hausse modeste des tarifs de bus en 2013 a déclenché un mouvement national contre les inégalités et l’abandon urbain, forçant les villes à affronter les questions du transport public, du logement et des droits. Au Chili, une augmentation de 30 pesos des tarifs du métro de Santiago en 2019 a déclenché l’Estallido Social — une révolte partie des stations et répandue dans les rues, exigeant une nouvelle constitution pour démanteler des décennies de privatisation, des retraites à l’eau. Ces mouvements ont commencé par le droit de se déplacer et sont devenus des luttes pour le droit de vivre.
Pour tenir le gouvernement responsable de notre ville, nous devons d'abord avoir la conception de la ville comme la nôtre — à tous. Cette idée a été discrètement démantelée, vendue mètre carré par mètre carré, tandis qu’une classe moyenne dépolitisée et une classe ouvrière réprimée produisent ensemble ce qu’est Delhi aujourd’hui : une ville qui étouffe en silence.
Pour que l’Inde survive, la politique doit respirer de nouveau.
Varsha Gandikota-Nellutla est la Coordinatrice Générale de Progressive International.
Photo : PTI/Karma Bhutia